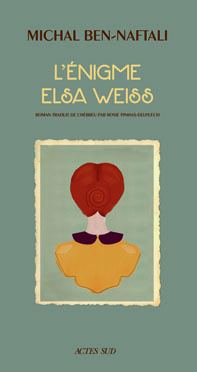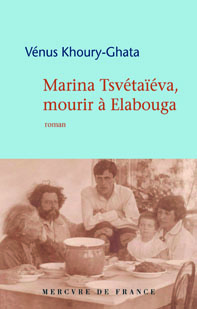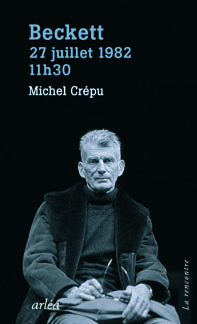ROMANS
Erwan Desplanques, L’Amérique derrière moi. Le jour de Noël, le narrateur apprend que son père, âgé de soixante-dix ans, est atteint d’un cancer des poumons incurable. Deux jours plus tard, sa femme lui annonce qu’elle attend un enfant. « Il ne m’échappait pas que ces deux horizons cohabitaient, se fondaient l’un dans l’autre, et qu’il me faudrait suivre deux croissances simultanées, celle d’une tumeur et d’un embryon qui aboutiraient aux résultats opposés, une mort et une naissance, deux réalités jumelles circonscrivant la totalité du spectre et qui, avec la célérité d’un tour de passe-passe, signeraient la disparition d’un père et l’apparition concomitante d’un fils. » La maladie du père et la perspective de sa perte occupent tout l’espace mental du fils, le ramènent au passé, à la nature de leur relation, à celle tissée avec le grand-père maternel, psychiatre, prisonnier pendant la guerre du Stalag XVII A en Autriche. Après un premier roman (Si j’y suis, 2013) et un recueil de nouvelles (Une chance unique, 2016), Erwan Desplanques, ancien journaliste à Télérama, fait ici le portrait d’une famille fantasque, la sienne. Avec pudeur, tendresse, lucidité et humour, il livre des bribes de son enfance et de son adolescence à Reims, décrit le couple volcanique puis harmonieux formé par ses parents. Il raconte les derniers moments de son père, l’impuissance des proches, l’incapacité des hommes de cette famille à exprimer leurs sentiments. Son père ancien militaire devenu assureur, était fasciné par les États-Unis et la guerre. Né en 1943, il aurait aimé être un héros américain, collectionnait les armes à feu, embarquait sa famille le samedi à bord de sa Jeep Willys ou de son Dodge, écrivait à ses proches en anglais, choisissait ses vêtements et ceux de ses deux fils dans des surplus de l’armée et présidait le comité de jumelage entre Reims et Arlington en Virginie. « Les États-Unis incarnaient à ses yeux la possibilité de s’inventer, de bâtir ses propres fictions. C’était une terre de conquête, de résilience, de progrès. » Entre décryptage des mythes familiaux, désir de changement, dernier souffle de son père et premier contact charnel avec son fils, le romancier trace une ligne de réflexion sensible porteuse d’un nouvel horizon. Éd. de l’Olivier, 176 p., 16 €. Élisabeth Miso
Arnaud Le Guern, Une jeunesse en fuite. Quand Tess la chienne de ses parents décède, l’auteur est surpris d’identifier des sanglots dans la voix de son père. Ce taiseux a en effet pour habitude de dissimuler ses émotions. Longtemps anesthésiste-réanimateur au sein du Service de santé des armées, il exerce au CHU de Brest et ne se résout toujours pas à prendre sa retraite. L’affection de Tess lui a été précieuse à son retour de la guerre du Golfe, à un moment critique de son existence où il a dû se rendre à l’évidence qu’il n’était plus le même. « Depuis mon retour de la guerre du Golfe, je me sens déphasé, incompris parfois. Je me sens seul avec ce que je vis, ce que je ressens. », confesse-t-il à son fils au téléphone. Arnaud Le Guern n’a jamais décelé cette faille chez son père et a totalement enfoui ce chapitre de sa jeunesse. Venu rejoindre pour l’été sa fille Louise et une de ses amies chez ses parents à Trez-Hir (Finistère), il se replonge dans les lettres que son père envoyait de Riyad puis de Koweït City et dans ses souvenirs d’adolescent. Au début de l’année 1991, il a quinze ans, habite Brest, préfère Guns N’ Roses et Jil Caplan à Jean-Jacques Goldman ou Patrick Bruel, fait partie d’une équipe de basket, vénère le footballeur Roberto Cabañas du FC Brest Armorique et le tennisman Víctor Pecci. Il se passionne pour la plastique d’Ellen Barkin, Stephanie Seymour, Elsa, Vanessa Paradis ou Muriel Moreno la chanteuse du groupe Niagara, commence à être sérieusement obsédé par les filles avec sa bande de copains, découvre Charles Bukowski et le film X de Canal+ chaque premier samedi du mois. Il a apprivoisé le manque lors des précédentes missions du père au Tchad et au large de Chypre, mais l’opération Tempête du désert qui le tient éloigné de janvier à mai 1991 réveille cette fois une véritable inquiétude. Il suit de près l’offensive de la coalition conduite par les États-Unis contre Saddam Hussein sur France Info et dans le journal de Guillaume Durand sur la Cinq. Les lettres du médecin militaire traduisent l’ennui, le chaos observé, le danger des opérations de déminage et le fils quarantenaire devenu père à son tour y cherche, en plus d’une fenêtre ouverte sur son passé, des éléments de compréhension de ce père resté mystérieux pour lui. Arnaud Le Guern rend un délicat hommage aux siens. Éd. du Rocher, 232 p., 17,90 €. Élisabeth Miso
Michal Ben-Naftali, L’Énigme Elsa Weiss. Traduction de l’hébreu Rosie Pinhas-Delpuech. « Elle avait le visage d’un animal, avec l’orgueil et l’obstination de ceux qui ne parlent à personne, visage de madone et de prêtresse, oppressant, tourmenté et, parvenu au paroxysme d’une angoisse existentielle émoussée, il se muait en un masque opaque qui mettait le regard en fuite. » Le 28 mars 1982, Elsa Weiss, sexagénaire, s’est jetée du toit de son immeuble. Elle enseignait l’anglais dans un lycée de Tel-Aviv. Michal Ben-Naftali, essayiste, éditrice, traductrice et professeur de littérature française à l’Université de Tel-Aviv a été son élève à la fin des années 1970 et en garde un souvenir marquant. Sévère, humiliante, exigeant une concentration de tous les instants, « (...) elle était inaccessible, fermée à toute manifestation de solidarité, d’identification ou d’empathie. », ne laissait rien filtrer de son intimité, de ses pensées, refusait de se sentir liée à qui que ce soit. En de rares occasions, la distance s’effaçait fugacement comme cette fois où son regard s’est troublé à la lecture d’un passage de la nouvelle Eveline de Joyce. La romancière s’est emparée des minces éléments biographiques à sa disposition pour inventer une vie à cette figure énigmatique. Elle lui dessine une enfance dans une famille juive réformiste de Kolozsvár en Transylvanie, annexée par la Hongrie en août 1940. Son union raisonnable avec Erik Weiss, révèle une jeune femme incapable de « définir pour elle-même et les autres ses propres frontières et ce qui est bon ou mauvais pour elle. » Juillet 1944, elle est l’une des 1834 passagers du « train Kastner », du nom de Rudolf Kastner, ce journaliste et avocat qui sauva des juifs hongrois de l’extermination en négociant avec les nazis, fut jugé pour cela en Israël, assassiné en 1957 et réhabilité en 1958. Elsa Weiss était donc « victime mais pas une victime pure, là était la question, si elle avait eu la vie sauve grâce à des négociations avec les nazis, cela signifiait qu’elle n’était pas une victime pure, ni une survivante pure, mais plutôt une survivante impure. » Comment supporter cette idée ? Elsa Weiss est restée muette. Désireux de s’intégrer et d’édifier un pays neuf, les rescapés de la Shoah arrivés en Israël après la guerre ont refoulé leur passé tragique. C’est ce silence individuel et collectif que sonde Michal Ben-Naftali dans ce puissant premier roman couronné par le prix Sapir 2016. Éd. Actes Sud, 210 p., 21 €. Élisabeth Miso
BIOGRAPHIES
Vénus Khoury-Gata, Marina Tsvétaïéva, mourir à Elabouga. « L’Union des écrivains a fini par se pencher sur ton cas. La place qui t’attend dans une maison de retraite est un cadeau du ciel. On t’accueille à bras ouverts avant de se rétracter. Tes jugements tranchants, tes airs supérieurs te valent l’inimitié des autres pensionnaires. Ils ricanent lorsque tu dis avoir connu Alexandre Blok, Gorki, Bounine, Maïakovski ou quand tu évoques ta correspondance avec Rilke ou Pasternak. (p.174) » De tous les poètes, Marina Tsvétaïéva (1892-1941) est la plus proche d’elle, dira l’écrivaine libanaise dont la propre enfance et la jeunesse furent également marquées par la misère, la perte, le rejet, et qui, à partir des pages de son journal, de ses recueils, de ses lettres, la tutoyant telle une sœur, construit un portrait de l’immense poétesse russe et de son destin tragique et sans concession. Amoureuse comme on respire, bourgeoise désargentée, mère désespérée de ne pouvoir nourrir ses enfants, Marina Tsvétaïéva déplaît dans la Russie devenue rouge qui voudra assassiner tous les poètes. Les années de guerre civile connaissent une grande famine. Ses exils successifs à Prague puis en France ne la sauvent pas. Sa poésie est anticonformiste, elle publie peu, vit à peine de ses traductions, et survit de la compassion de ses amants. Elle aime à tout va, est la maîtresse de tous ceux qui l’approchent ; éditeurs, poètes, écrivains, critiques littéraires qui disent du bien de ses poèmes ; elle aime Rilke qui lui préfère Lou-Andréas-Salomé, elle aime Pasternak (qui en épousera une autre mais la protègera) à qui elle écrira pendant 17 ans, une, deux voire trois fois par semaine. Le monde gelé comme un champ de pommes de terre est la dernière image que la poétesse emportera avec elle d’Elabouga, au moment où juchée sur une chaise, entre les murs d’un grenier, elle se pendra. Éd. Mercure de France, 195 p.,15,50 €. Corinne Amar.
Michel Crépu, Beckett, 27 juillet 1982 11h30. En 2017, déjà, dans Un jour (Gallimard), alors qu’il raconte comment il a accompagné la fin de son père, l’auteur évoquait Beckett et Fin de partie pour dire le naufrage d’un homme atteint de la maladie d’Alzheimer ; sur son blog de la NRF (03/12/2015, Beckett au clair de lune) il ne manquait pas de signaler - de Stéphane Lambert à Anne Atik - avec enthousiasme, avec gourmandise comme avec envie, les ouvrages qui osaient converser avec Beckett. On rit beaucoup avec Sam, comme on rit au pub, après une journée de pluie torrentielle, se souvenait-il, en évoquant ses lectures, en se demandant (blog toujours, trois ans plus tard) quelle était la place de Beckett en 2019, homme et œuvre confondues pour ce Prix Nobel peu soucieux de projecteurs qui avait envoyé son éditeur à sa place à Stockholm chercher sa médaille, et qui demandait à la philosophie de pouvoir donner une forme à sa détresse. Éléments pour un essai. Trop d’éléments, trop de proximité, trop de réflexions intimes, de lectures profondes de Beckett ; tangente tentante mais impossible. Le livre est né. C’est un petit essai spirituel, personnel, ironique et doux, à l’image qu’on s’imagine de son auteur, sur la vie et l’œuvre de Samuel Beckett, né dans la banlieue de Dublin au début des années 1900, installé à Paris en 1928, ami de Joyce, qui se fera connaître en France grâce à l’éditeur Jérôme Lindon, avec son premier texte aux éditions de Minuit, Molloy (1951), puis Malone meurt (1952), L’Innommable (1953)... « Je viens maintenant à ce rendez-vous de juillet 1982 où j’eus tout le loisir de détailler l’étrange douceur qui émanait de sa personne. J’y ai souvent repensé depuis mais c’est seulement aujourd’hui que je m’avise de cette ressemblance profonde avec mon grand-père. Elle a joué son rôle souterrain au long de toutes ces années où je ne pensais pas à mon grand-père et où j’étais entièrement occupé de Beckett. » Double hommage. Éd Arléa, 85 p., 16 €. Corinne Amar