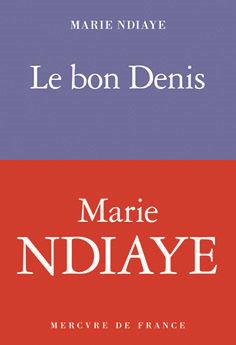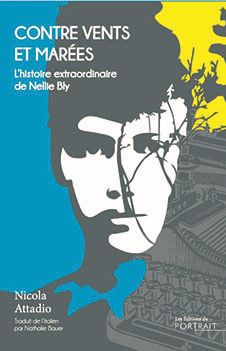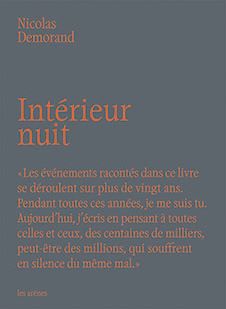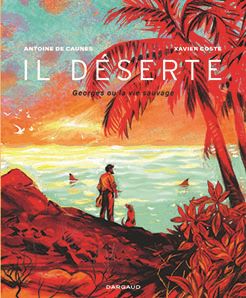Récits
Marion Muller-Colard. Croire qu’est-ce que ça change ? C’est une lettre d’amour qu’une mère écrit à son fils aîné de vingt ans pour lui dire pourquoi elle croit et ce que croire change pour elle. « Je me souviens d’un soir d’été, sur la terrasse, un de ces soirs si calmes que les conversations éclosent même entre les plus taiseux d’entre nous. J’avais osé te poser cette question – Est-ce que tu déplores que j’aie si peu parlé de ma foi avec vous ? » Dans cette famille pudique, les deux frères ont grandi entre une mère théologienne, croyante, et un père agnostique, dans un silence sinon un respect de la religion tel que le fils ose, à brûle pourpoint en pleine nuit, dans un sms demander à sa mère comment il est possible qu’elle soit encore angoissée alors qu’elle est si profondément croyante ? À ce moment-là, survient le questionnement : pourquoi la foi guérirait-elle de l’angoisse ? Quel rapport existe-t-il entre l’une et l’autre ? Est-ce pour cela qu’on croit ? Croire serait-il un contrat entre moi et Dieu ?
Entre la mère et le fils, il y a un rendez-vous à ne pas manquer. Nourrie d’exemples, de citations littéraires, philosophiques, religieuses voire cinématographiques, s’appuyant sur des propos de non-croyants ou de croyants, elle choisit d’écrire pour dire, pour expliquer à quel endroit secret d’elle, croire la fait descendre. Elle remet en cause cette étanchéité entre croire et savoir – croire n’est pas savoir – ou encore, nous accorde que la confiance est « une prise de risques ». Au cœur des doutes et des pseudo certitudes, croire, précise-t-elle, peut être un croire intransitif : croire en rien, croire, comme un élan nous porte. Nous sommes tous, nous dit-elle, des croyants, et la foi est une œuvre de participation : il s’agit de transmettre ce quelque chose sans que cela se transforme en attentes, en pensées magiques. C’est un texte aussi court que dense, à la couverture bleu espérance, qui dit que croire est un pari et un parti pris, et qui touche au cœur par sa lumière. Éd. Labor et Fides, 108 p., 10 €. Corinne Amar
Marie NDiaye, Le bon Denis. Avec Le bon Denis, Marie Ndiaye dessine un autoportrait autour de l’absence de la figure paternelle. Mêlant récit et fiction, elle compose quatre variations d’une narratrice en quête d’une vérité sur l’abandon du père. Dans le premier texte, une femme dialogue avec sa mère à la mémoire défaillante, dans une maison de retraite. La fille interroge sa mère sur le départ de son père quand elle était bébé. La mère prétend que c’est elle qui a rompu, alors éprise d’un certain Denis, à la bonté prodigieuse. Elle l’assure que cet homme, dont elle n’a aucun souvenir, l’aurait choyée comme sa propre fille. Incrédule, la narratrice tente d’obtenir plus de détails concrets sur ce « bon Denis ». Dans le deuxième texte, la romancière déroule en parallèle l’enfance et la jeunesse de ses parents. Sa mère a vu le jour dans une famille d’agriculteurs de la Beauce et même si la vie était rude, elle n’a jamais douté de l’amour des siens. Son père a grandi au Sénégal dans la misère et la maltraitance. « Il n’éprouverait jamais ni pitié ni compassion, et la tendresse lui serait un sentiment étranger. » Tous deux sont parvenus à s’arracher à leur condition, par leur détermination à faire des études. Dans le troisième mouvement du livre, Marie Ndiaye se penche sur son cheminement intérieur, sur l’évolution, au fil du temps, de sa perception de son histoire familiale. « Enfant, j’ai toujours cru que mon père n’avait pu que se sentir, à Dakar, accablé, asservi, empêché et que son arrivée miraculeuse à Paris avait fait paraître le modeste mais incontestable génie que renfermait son long corps maigre, souple, retenu. » Elle le jugeait « seul comptable de tous ses défauts », pour avoir quitté femme et enfants et le pays qui l’avait accueilli. Puis, elle a entrevu le mépris et le rejet qu’avait pu susciter sa peau noire. La dernière partie met en scène une jeune femme de dix-neuf ans, venue rencontrer en Amérique un père trop longtemps fantasmé. En quatre fragments à la puissance formelle saisissante, Marie Ndiaye sonde le trouble inextricable auquel nous exposent notre mémoire imprécise, notre imagination et nos questionnements identitaires. Éd. Mercure de France, Traits et portraits. 136 p. 18,50 €. Élisabeth Miso
Biographies / Autobiographies
Nicola Attadio, Contre vents et marées, l’histoire extraordinaire de Nellie Bly. Traduit de l’italien par Nathalie Bauer. « Je n’ai jamais écrit un seul mot qui ne vienne de mon cœur. Je ne le ferai jamais. ». Elizabeth Jane Cochrane (1864-1922), dite Nellie Bly, première femme reporter américaine, considérait que « la presse n’a de sens que si elle contribue à améliorer la vie des individus. ». Nicola Attadio retrace sa trajectoire exaltante. Le monde de Nellie Bly bascule à la mort de son père, un riche commerçant de Pennsylvanie. Sa mère se remarie avec un homme alcoolique et violent. Sa fille se jure de ne jamais connaître le même destin ni de dépendre d’aucun homme. Elle ne peut poursuivre sa formation d’institutrice, mais elle est instruite et lit énormément. Indignée par un article sexiste du Pittsburgh Dispatch, elle adresse au journal une lettre des plus féministes. Cette première audace lui ouvre les portes de la rédaction. Dans un contexte de vent nouveau, impulsé par des patrons de presse comme Joseph Pulitzer ou William Randolph Hearst, elle va se révéler, d’abord à Pittsburgh puis ensuite à New York, une journaliste de premier ordre qui n’a rien à envier à ses confrères masculins. En cette fin de XIXe siècle, l’industrialisation transforme le pays, poussant de plus en plus d’hommes et de femmes vers les villes. S’affranchissant de la morale victorienne et des diktats bourgeois, Nellie entend bien occuper la place qu’elle mérite et invente un nouveau type de journalisme. Ses enquêtes immersives, qui dénoncent le cruel quotidien des femmes ouvrières ou internées à l’asile de Blackwell’s Island, forgent sa réputation. En 1890, elle gagne son pari de réaliser un tour du monde en moins de jours que Phileas Fogg. En 1895, elle épouse un riche industriel de l’acier et prend les rênes de son entreprise qu’elle métamorphose par sa vision humaniste. Ruinée, elle reprend la plume et couvre notamment l’investiture du président Woodrow Wilson et le grand défilé des suffragettes du 3 mars 1913. Toute sa vie, Nellie Bly n’aura eu de cesse de mettre sa combativité exceptionnelle et sa conscience sociale aiguë au service des plus faibles, au premier rang desquels les femmes et les enfants. Éd. du Portrait, 184 p., 21,90 €. Élisabeth Miso
Nicolas Demorand, Intérieur nuit. Depuis 2017, le journaliste de radio le plus exposé de France co-anime la matinale de France Inter, et l’exercice est chaque jour ambitieux, exigeant, imposant énergie et concentration maximales. Il révèle dans un récit des plus courageux parce qu’il s’y met à nu, la maladie mentale qui l’affecte depuis plus d’une vingtaine d’années. « Je suis malade mental et j’ai donc appris le silence, la dissimulation et le mensonge. Je me tais, je vis ce qui m’affecte dans la solitude, je rase les murs. Parfois je donne le change ou fais belle figure – alors que j’ai envie de mourir ». « J’aime les nuages… là-bas… les merveilleux nuages ! » Baudelaire lui sert d’exergue protecteur alors qu’il prend la décision de raconter son calvaire quotidien, alternant les phases up d’énergie et les phases down d’épuisement mental et physique, de souffrances psychiques, de pulsions d’en finir avec la vie. Entre les deux, il n’y a rien sinon cette terreur insurmontable que l’une ou l’autre de ces phases se manifeste.
C’est un texte bref, brûlant, dont les événements racontés se déroulent sur deux décennies et alors que l’auteur a pris la décision de ne plus se cacher, en pensant à tous ceux qui, en silence, souffrent du même mal. Il raconte son parcours médical, les séjours en hôpital psychiatrique, les traitements successifs inutiles, les médecins qui ne peuvent rien faire, la psychanalyse sans résultat… Il décrit les années d’errance avant qu’un diagnostic soit enfin posé, de désespérance parce qu’aucun médecin ne s’intéresse aux causes du mal ; il évoque la honte de ne pas se sentir normal, ce sentiment mortifère qui l'a conduit à dissimuler pendant tant d’années sa maladie, de peur de voir le regard des autres sur lui changer. La rencontre d’un psychiatre de l’hôpital Sainte-Anne qu’il appelle mon sauveur puis, un autre qui lui succède, lui permettent de trouver un traitement qui, enfin, le soulage. Un diagnostic est posé : bipolarité. Il peut être soigné, il peut vivre. Éd. Les Arènes, 112 p., 18 €. Corinne Amar
BD / Romans graphiques
Antoine de Caunes, Xavier Coste, Il déserte. Georges ou la vie sauvage. Quand Antoine de Caunes, cinéaste, acteur, animateur de télévision et de radio à la fantaisie débridée, a été sollicité pour un projet de bande-dessinée, l’idée lui est venue de raconter un événement marquant de son enfance. En 1962, son père Georges de Caunes, célèbre journaliste, obsédé par le personnage de Robinson Crusoé, décide de tout quitter durant un an, pour vivre sur une île déserte, tel un naufragé. Il compte commenter cette épreuve de survie et de solitude lors d’une émission radiophonique quotidienne. « Tenter cette expérience, c’était satisfaire à la fois son goût de l’aventure, son besoin de solitude, tout en s’éloignant des contrées dites « civilisées » où il ne trouvait pas son bonheur. » Il débarque avec son chien Eder sur Eioa, une île de la Marine nationale dans l’archipel des Marquises. Entre l’océan infesté de requins et de poissons non comestibles, le manque d’eau douce, la terre où rien ne pousse, la chaleur écrasante et les piqûres incessantes des moustiques nono, son séjour n’a rien de paradisiaque. Son fils Antoine, âgé de huit ans, ne comprend pas pourquoi son père a disparu de son horizon. Chaque soir, il écoute à la radio le récit de son aventure et l’imagine sur son île lointaine. Le jour de ses neuf ans, il guette un signe affectueux de sa part sur les ondes, en vain. Des décennies plus tard, il découvrira dans les pages de son journal intime que son père ne l’avait pas le moins du monde oublié ce jour-là. Le livre entrelace trois regards : celui du petit garçon perturbé par l’absence de son père, celui que porte aujourd’hui le septuagénaire qu’il est devenu sur cet épisode traumatisant de son passé et celui du père, aux prises avec ce caillou terriblement inhospitalier qui l’obligera, au bout de quatre mois, à renoncer à son rêve d’enfant. Les magnifiques planches de Xavier Coste, aux couleurs éclatantes, donnent vie au décor insulaire et aux pensées des deux protagonistes et du chien Eder. Antoine de Caunes, signe une délicate réflexion sur les liens père-fils et sur le temps qu’il lui a fallu pour mieux cerner ce père, si loquace dans son métier et si taiseux avec ses proches. Éd. Dargaud, 208 p., 30 €. Élisabeth Miso