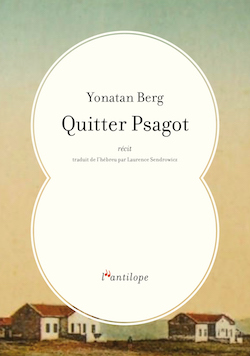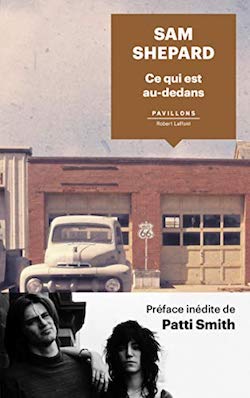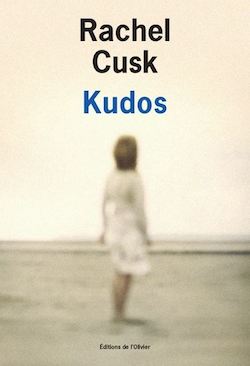RÉCITS
Philippe Annocque, Les Singes rouges. Une petite fille aux pieds nus traverse le dancing et s’installe sur l’estrade. Devenue une vieille dame, son fils l’écoute et fait réapparaître l’enfant des lointains. Il a recopié les mots de sa mère, scrupuleusement. Le livre de Philippe Annocque organise les fragments d’une vie dont il est le fruit. Il écrit que prénommer sera l’un des sujets de ce livre. Mais le pronom y est aussi saillant que le nom propre. Le pronom, cet il, conduit un texte fait d’images, de prénoms, d’histoires, de noms de lieux. Guyane, Martinique. Les récits sont de plus en plus étoffés. De plus en plus peuplés. Le lecteur, dont Philippe Annocque se soucie sans cesse, est introduit dans une famille puis dans un monde. Le texte est au départ laconique, presque embarrassé comme on peut l’être quand on présente des personnes qui se rencontrent pour la première fois. Au fil des pages, l’aisance gagne et les silences font place à une prose plus volubile. Cette évolution traduit le scrupule de l’auteur, celui d’être fidèle aux souvenirs recueillis. Un mélange de rigueur et de fantaisie anime ce livre, déjouant ainsi ce qui pourrait le plomber. Ainsi quand il aborde le changement de prénom de sa mère. Olga n’est pas restée Olga. Elle est devenue Marie-Thérèse. Le prénom Olga étant jugé trop dur pour elle. Son nouveau prénom, elle l’aime parce qu’il est prononcé avec douceur. L’affection porte le récit de bout en bout. Fragmenté puis tissé, il fait apparaître une histoire prise dans la grande histoire. Le changement de prénom n’est pas dramatique et s’inscrit dans une coutume de l’époque et du lieu où a grandi la petite Olga. « Il semblerait que ce soit un héritage inconscient de pratiques magiques; on pourrait jeter un sort grâce au prénom, le quimbois est resté vivace longtemps aux Antilles ». Recueil des souvenirs de sa mère, mais pas seulement. Qu’est-ce d’autre? Un inventaire d’expériences. Et celui qui nous en fait part se montre lui-même en action, c’est-à-dire dans l’expérience de l’écriture. Il distingue sans cesse la réalité vécue et l’usage qui en est fait. Ici, un texte. Il s’observe en train d’écrire en même temps qu’il suit des yeux sa protagoniste. Une petite fille en robe blanche, chaussée de bottines. Une petite fille qui porte un chapeau de paille. Elle vit dans un endroit ensoleillé. Elle passera de la Guyane à la Martinique, rejoindra Paris. Tout en demeurant l’enfant qui vit non loin des singes rouges. L’art poétique de Philippe Annocque instaure une distance entre sa mère et lui. Distance féconde qui lui permet d’exprimer les lointains. Les temps lointains, les pays lointains, les mœurs lointaines dont le narrateur découle. Éd. Quidam, 2020, 172 p., 18 €. Gaëlle Obiégly.
Yonatan Berg, Quitter Psagot. Traduit de l’hébreu par Laurence Sendrovicz. Psagot est le nom d’une colonie juive de Cisjordanie proche de Ramallah – capitale administrative de l'Autorité palestinienne ‑ où l’auteur, né (en 1981) dans une famille pratiquante, a grandi. Un milieu à la fois protecteur et oppressant. Quitter Psagot raconte la rupture de l’auteur avec son milieu d’origine, religieux et nationaliste, déjà au cœur de son premier roman, Donne-moi encore cinq minutes (L’Antilope, 2018). En une écriture concise, des chapitres plus ou moins brefs annoncés par des titres éloquents ; Le bain rituel, Le pavillon de mes parents, La synagogue, Foot, Pionniers…, il revient sur son enfance, son adolescence, se remémore les jeunes de là-bas (de Ramallah) qui jouaient au foot sur la route qui les séparait, les cerfs-volants qui volaient dans les airs les jours de fête, dans cette ville arabe voisine – les uns et les autres, dans une impossibilité de communiquer. « Je me souviens d’un troupeau de gamins en sueur, certains avec papillotes, d’autres une main sur la tête pour tenir leur kippa, se ruant derrière cette évocation ailée et bigarrée de l’enfance d’en face. Nous avions la sensation d’avoir sous les yeux notre propre image – même âge, même comportement, mêmes réactions à la chaleur torride de l’après-midi – mais nous avions aussi la sourde assurance d’un combat futur. » Plus loin, l’évocation de ce désir de rapprochement, en côtoyant les ouvriers palestiniens – Psagot, comme d’autres colonies, ayant été construite par des Palestiniens – à l’heure de leur pause déjeuner, l’envie de s’asseoir à côté d’eux, de boire avec eux leur café turc dans les tasses minuscules qu’ils utilisaient. Il évoque le service militaire, puissant chapitre où se dit non seulement la machinerie israélienne avec ses codes, mais la violence, la terreur de la mort, la solidarité entre soldats – ceux venus de la ville, Tel Aviv, et lui, venu de cet endroit reculé et provincial… Quitter Psagot, tel le rêve d’un ailleurs, mais aussi un arrachement. Éd. L’Antilope, 255 p., 22 €. Corinne Amar
VS. Naipaul, Étrange est le chagrin. Traduit de l’anglais par Béatrice Vierne. « Nous n’en avons jamais fini avec le chagrin. Il fait partie du tissu de la vie. Il attend toujours de nous tomber dessus. L’amour rend les souvenirs et l’existence précieux ; le chagrin qui nous envahit est à la mesure de cet amour et il est impossible d’y échapper. » C’est un petit texte, inédit, ramassé, à la phrase aussi précieuse que le texte est bref, écrit quelques mois avant sa mort en 2018 – dernier inédit en français de V. S. Naipaul (1932-2018), écrivain britannique, issu d'une famille d'Indiens de Trinidad, et prix Nobel de littérature en 2001. Il évoque dans ce récit le sentiment de chagrin et de deuil qu’il ressentit fortement en trois occasions de sa vie. D’abord, lorsqu’il perdit son père, décédé à Londres – le temps de prendre le train d’Oxford où il vivait, pour aller se recueillir sur sa dépouille, le chagrin, pour la première fois venait de prendre possession de lui, il avait vingt et un ans ; trente ans plus tard, c’est la mort de son frère aimé, Shiva, qui le bouleverse, le fait revenir en arrière sur les souvenirs d’enfance qu’ils avaient en commun ; et enfin, celle de son chat, Augustus, aux derniers jours de sa vie, bagarreur dans ses escapades et fidèle compagnon de l’auteur qui nous livre ses réflexions, partageant le fait de survivre à l’absence ou de vivre après la disparition de l’être aimé. Une postface de l’écrivain, romancier américain et ami de longue date, Paul Théroux, rend hommage à V.S. Naipaul. Il avait vingt-cinq ans, Naipaul en avait trente-quatre, il évoque leur première rencontre, en Ouganda, à Kampala, où ce dernier venait d’intégrer le département d’anglais de l’université en qualité d’écrivain résident. Il se souvient de ses colères légendaires, de son tempérament impulsif, ses provocations, sa haute estime de lui-même, mais aussi de ses difficultés de carrière, de ses goûts en littérature, de son intransigeance : « Si quelqu’un qui compte pour vous vous déçoit, laissez-le donc tomber. » Éd. Herodios, 45 p., 10 €. Corinne Amar
ROMANS
Sam Shepard, Ce qui est au-dedans. Préface de Patti Smith. Traduction de l’anglais (États-Unis) Bernard Cohen. « Tandis que le livre se déployait, j’étais éblouie par le panache de son écriture, un mélange narratif de poésie filmique, d’images du Sud-Ouest, de rêves surréalistes et de son humour noir si singulier. Des aperçus de ses défis présents émergeaient ici et là, vagues mais indéniables. » Dans L’Année du singe (Gallimard, octobre 2020), Patti Smith commente en ces termes Ce qui est au-dedans dont elle a signé la préface. En 2016, elle a aidé son ami Sam Shepard, diminué par la maladie de Charcot, à apporter les dernières modifications à son manuscrit et ne pouvait imaginer vieillir sans lui. Sam Shepard, l’écrivain, dramaturge, scénariste et acteur aux nombreuses récompenses et à la beauté magnétique, est mort en juillet 2017. Le narrateur de son dernier roman, sans être tout à fait son double, lui ressemble à bien des égards. Un homme se réveille à l’aube, dehors les coyotes hurlent. Son esprit vagabonde, et le livre, sorte de collage de fragments épars, s’articule ainsi au gré de ses souvenirs, de ses rêves et de ses cauchemars. Le narrateur, écrivain et acteur, se revoit adolescent, rêvant de mettre les voiles et de devenir joueur de golf professionnel. Des figures du passé surgissent telle Felicity, la très jeune amante de son père qui le troublait tant et à laquelle il n’a pu résister. « Elle a ouvert la bouche et j’ai vu des animaux minuscules s’en échapper, de petites créatures emprisonnées en elle pendant tout ce temps. Ils fusaient au dehors comme s’ils craignaient d’être à nouveau capturés et rendus à leur geôle. Je les sentais tomber sur mon visage et se faufiler dans ma chevelure, à la recherche d’une cachette. À chaque fois qu’elle criait, les animaux sortaient en brefs nuages, tels d’infimes moucherons, de menus dragons, poissons volants, chevaux sans tête. » Son père, cet être taiseux lui apparaît fréquemment, dans une version miniature. La fascination des femmes ne l’a jamais quittée comme le révèlent les passages consacrés à l’audacieuse Felicity, à son ex-femme, compagne de trente ans ou encore à la Jeune Maîtresse-Chanteuse de 19 ans, bien décidée à publier leurs conversations téléphoniques qu’elle a enregistrées. Un homme, dont le corps se dérobe à sa volonté, déroule avec lucidité le film de sa vie et nous parle de désir, de détachement, de littérature, de plateaux de cinéma, de paysages américains, de chiens, de chevaux et d’autres animaux encore dont il aime à observer la grâce. Éd. Robert Laffont, 234 p., 21 €. Élisabeth Miso
Rachel Cusk, Kudos. Traduction de l’anglais Cyrielle Ayakatsikas. Après Disent-ils (2016) et Transit (2018), Rachel Cusk clôt son ambitieuse et troublante trilogie romanesque. Dans ce dernier volet, son héroïne Faye, écrivaine et divorcée comme elle, mère de deux grands enfants, se rend dans une ville européenne pour participer à un festival littéraire. Pendant ces quelques jours, elle observe, échange, écoute les histoires des autres, absorbe ce qui filtre de leur quotidien, de leur rapport au monde et au réel. Voisin de siège dans l’avion, écrivains, éditeurs, journalistes, toutes les personnes croisées, se dévoilent intimement. Leurs angoisses, leurs frustrations, leurs névroses, leurs désillusions amoureuses, leurs inquiétudes parentales, rencontrent ses propres questionnements existentiels. « J’avais toujours considéré la souffrance comme une opportunité mais je n’étais pas certaine de découvrir un jour si c’était vrai et, si oui, pourquoi ça l’était, car jusqu’à présent j’avais échoué à comprendre en quoi consistait cette opportunité. Tout ce que je savais, c’était qu’il y avait quelque chose de gratifiant quand on y survivait, et que l’on se sentait alors plus proche de la vérité, mais que ce sentiment était peut-être finalement similaire à celui qu’on éprouve lorsqu’on reste dans un même endroit. » Dans un subtil jeu de reflets, de miroirs, Rachel Cusk interroge les récits que nous faisons de nos vies et de nous-mêmes. Elle poursuit son exploration de la féminité, de la maternité, des rapports homme-femme, de la création littéraire, de l’aliénation affective et sociale. Sonde la construction d’une identité féminine, entre combats contre soi-même et contre les diktats sociaux. De livre en livre, elle dessine un autoportrait en filigrane, le complexe parcours d’une femme et d’une écrivaine vers la liberté. Éd. de l’Olivier, 208 p., 22 €. Élisabeth Miso
Eduardo Halfon, Canción. Traduction de l’espagnol (Guatemala) David Fauquemberg. Eduardo Halfon aurait dû décliner la surprenante invitation de participer à un congrès d’écrivains libanais à Tokyo, mais l’envie de découvrir le Japon était trop forte. La méprise venait sans doute du portrait dans ses écrits de ce grand-père libanais qui avait fui Beyrouth à seize ans en 1917 pour émigrer aux États-Unis et finalement s’établir au Guatemala. Or, le Liban ne s’est constitué officiellement en tant que nation qu’en 1920. L’occasion était cependant trop belle, de se pencher à nouveau sur sa romanesque histoire familiale et sur cet aïeul, en s’attardant plus précisément sur l’épisode de son enlèvement en 1967 par les Forces armées rebelles. Un matin de janvier 1967, son grand-père paternel a été kidnappé devant chez lui par quatre hommes déguisés en policiers, puis retenu prisonnier trente-cinq jours dans une résidence clandestine. L’un d’eux, surnommé Canción, avait le visage d’un enfant. « Mais le tempérament de Canción, affirmaient ses camarades, peut-être pour compenser son apparence clairement infantile, avait la froideur et le calme d’un tueur professionnel ou d’un soldat (ce qui, finalement, revient au même). » Avant d’être libéré, l’otage avait offert à ce geôlier plutôt cordial les deux stylos plume en or qu’il avait dans sa poche. Impliqué dans l’assassinat de l’ambassadeur des États-Unis en 1968 et dans le rapt de celui de la république Fédérale d’Allemagne en 1970, le guérillero a mystérieusement été abattu au Mexique. Comme il l’a déjà démontré dans le magnifique Deuils qui racontait son enquête sur le mythe familial de son oncle mort enfant, l’auteur guatémaltèque excelle à prendre pour matériau littéraire la mémoire et à entrelacer histoire intime et histoire collective. L’événement familial ici restitué, trouve sa place dans le contexte de la longue spirale de violence qu’a connu le Guatemala après le renversement du président Árbenz par la CIA en 1954. Évoquer son grand-père permet à Eduardo Halfon de se plonger dans ses souvenirs, dans ce que son enfance a déposé en lui de si précieux, comme ce décor inoubliable de la demeure de ces grands-parents qui « n’était pas une maison, ni même un palais, mais plutôt un alcazar : un lieu splendide, ostentatoire, nimbé d’une aura d’eucalyptus et de grandeur. » Éd. La Table Ronde/Quai Voltaire, 176 p., 15 € (à paraître le 14 janvier). Élisabeth Miso