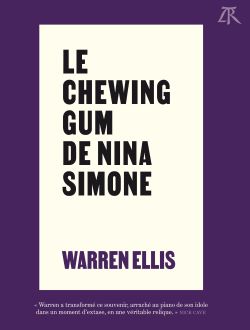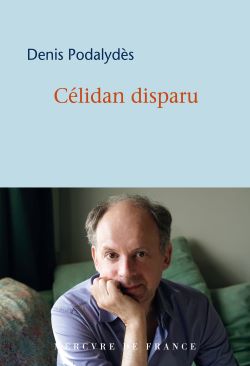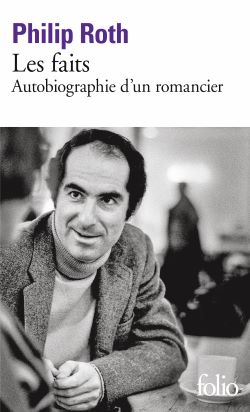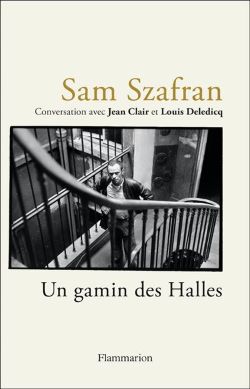JEUNESSE
Thierry Maricourt - Nathalie Dieterlé, Frérot Frangin. Hôtel bestiole, hôtel bagnole. Après Tardi et Zaü, c’est Nathalie Dieterlé qui illustre le texte de Thierry Maricourt pour ce troisième épisode des aventures de Frérot Frangin. Le narrateur se replonge dans la correspondance qu’il entretenait dans sa jeunesse avec son frère, conservée dans des boîtes à chaussures. « Un gros tas de boîtes dans un coin du grenier, comme un ours, dos rond, qui sommeillerait depuis le début de l’hiver. » Deux frères, nés à huit ans d’intervalle, s’écrivent, se confient leur quotidien et partagent leur perception du monde qui les entoure. Frangin, l’aîné qui a séjourné en prison, a trouvé une place de mécanicien dans un garage. Le travail lui plaît, mais le salaire est maigre et il a manqué de se faire renvoyer pour avoir oublié une part de clafoutis dans la boîte à gants d’un client. Pas toujours facile de garder sa bonne humeur face à un patron revêche, des collègues et des clients ronchons. Le meilleur conseil qu’il puisse donner à Frérot, c’est d’éviter autant que possible les crétins de toute sorte. « T’es pas mon Frangin pour rien, toi ! Quand moi je suis d’humeur zéro bulle, mes meilleurs potes, ce sont les piafs, les cadors, les minous et toutes les autres bestioles qui nous laissent vivre en paix – et toi. », lui répond son cadet qui découvre, lui aussi, certains aspects peu reluisants de la nature humaine. Le chat de gouttière qui avait élu domicile dans leur cage d’escalier a été empoisonné. Frérot, révulsé par l’idée qu’on puisse maltraiter des animaux, s’est lancé avec sa bande d’amis, sur les traces de l’assassin. Les lettres laissent filtrer toute la tendresse qui unit les deux frères, la pudeur avec laquelle ils s’inquiètent et veillent l’un sur l’autre à distance. Éd. Le Calicot, 64 p., 14 €. Ouvrage publié avec le soutien de la Fondation La Poste. Élisabeth Miso
RÉCITS
Ellis Warren, Le Chewing-Gum de Nina Simone. Traduction de l’anglais Nathalie Peronny. Introduction de Nick Cave. Le 1er juillet 1999, la prestation de Nina Simone, au Meltdown Festival à Londres, subjugue littéralement le public. Nick Cave, en charge de la programmation cette année-là, et Warren Ellis assistent à un des plus incroyables concerts de leur vie, à la fascinante transfiguration de leur idole. À la fin du concert, Warren Ellis se précipite sur la scène pour s’emparer du chewing-gum collé par la Diva du jazz sous le piano et de sa serviette-éponge. Il glisse le tout dans son attaché-case, emportant avec lui un peu de l’esprit de cette déesse. Pendant vingt ans, le compositeur et multi-instrumentiste australien conserve religieusement le chewing-gum. En 2019, Nick Cave, en pleine élaboration de l’exposition que lui consacre la Bibliothèque royale du Danemark, sollicite la participation de son complice de longue date. Warren Ellis lui propose alors la précieuse relique et son vieux violon hors d’usage, gravé et rafistolé. « Le moment était venu de le restituer au monde. Je ne m’étais jamais posé la question de ce qu’il pourrait signifier ou représenter aux yeux d’un tiers. Pour moi, c’était un objet très personnel, placé à côté d’autres totems qui me redonnaient du courage dans les moments difficiles. Les forces invisibles. » Parce qu’il craint de voir se tarir sa créativité s’il se sépare de cette minuscule trace de génie, il décide de le faire dupliquer. Dès qu’il révèle l’existence du chewing-gum, il s’émeut des réactions que cela déclenche, du mystérieux pouvoir des objets. Toutes les personnes qui collaborent à la transformation du chewing-gum, en vue de sa présentation à Copenhague, sont d’une manière ou d’une autre particulièrement sensibles au rayonnement de « ce petit objet investi d’une histoire immense ». Le livre, ponctué d’une centaine de photographies, raconte le cheminement de ce morceau de gomme, du secret à la lumière, et brosse un autoportrait de l’auteur à travers sa relation aux objets, à la musique et à la transmission. Les trésors qu’il dénichait enfant dans une décharge de Ballarat en Australie, les objets insolites qui le suivent en tournée ou en studio, sa formation musicale, les musiciens qui l’ont profondément marqué ou les rencontres inspirantes, sont autant de « capsules temporelles » qui nous éclairent sur son parcours artistique et personnel. La musique lui a permis de trouver sa place en ce monde. « Les mots me touchaient sans que je parvienne à trouver les miens. Mais la musique, je pouvais y accrocher un tas de choses, exprimer des émotions sans paroles. Une suite d’accords suffisait à me couper le souffle. La musique était un cintre vibrant. » Éd. La Table Ronde, 100 illustrations, 215 p.,28,50 €. Élisabeth Miso
Denis Podalydès, Célidan disparu. « Je ne vis pas tout à fait au présent. Une pente naturelle, à toute heure du jour, m’envoie dans le passé souvent même antérieur à ma naissance. Avant qu’il n’y avait le monde. C’est comme un bureau où je me retire fréquemment et travaille. » Avec ce recueil de nouvelles autobiographiques, Denis Podalydès a voulu retrouver des instants, des sensations disparues. Des moments de honte ou de gêne qui stimulent toujours son écriture, mais aussi des moments de détresse, de grâce ou de grande joie. Il y déploie sa passion pour la littérature, pour son métier d’acteur et de metteur en scène, décrit avec finesse le processus à l’œuvre chez un comédien pour donner vie à un texte, cette nécessité qu’il cultive depuis l’enfance, cette « (…) capacité d’amalgamer à mes propres mots les mots des autres, à les faire miens plus que les miens (…) » Enfant, il traçait les contours d’un pays imaginaire et avait même inventé sa propre langue, le penherois. Déjà le désir tenace d’être un autre, d’être né ailleurs, qu’il pourra assouvir plus tard à travers la fiction de ses rôles au théâtre et au cinéma. Il se souvient des vacances en famille, en Bretagne puis à Oléron, de ses jeux avec son frère Bruno, de leur infinie complicité qui se poursuit toujours dans leurs collaborations cinématographiques. De son plaisir immense à se plonger dans les livres, inoubliables bulles de bonheur dans la librairie de sa grand-mère ou lové contre sa mère. « Chaque fois que me prennent de profondes angoisses, de ces angoisses intolérables que rien ne peut apaiser, mon premier réflexe est de me réfugier dans une librairie. » Reviennent aussi des images douloureuses : la violence de son père, le suicide de son frère Éric qui s’est jeté du cinquième étage de l’immeuble familial, ses petites lâchetés sentimentales, son humiliation d’être éjecté en 1989 de la pièce Hernani. En 1991, il passe une audition dans le parc de Sceaux avec Christian Rist pour le rôle de Célidan dans La Veuve de Corneille, l’échange est magique. Depuis, il n’a plus jamais douté de sa vocation de comédien et s’est abandonné avec ferveur à ces personnages, à tous ces textes qui le captivent. Éd. Mercure de France, 336 p., 21 €. Élisabeth Miso
AUTOBIOGRAPHIES
Philip Roth, Les faits. L’auteur fait ici le récit sans fard de sa propre vie, depuis son enfance dans une famille juive américaine à Newark, dans le New Jersey au succès de ce qui fit de lui un immense auteur aux trente-et-un romans, obsédé de femmes et d’écriture. Le récit s'ouvre sur une lettre que le romancier adresse à son personnage et alter ego, Zuckerman, dans laquelle il s’interroge sur ce parti pris. « Cher Zuckerman, Dans le passé, tu le sais, les faits ont toujours été des notes jetées dans un carnet, qui m’assuraient un tremplin vers la fiction. Et voilà que je me surprends à écrire un livre radicalement à rebours. Je voulais me rappeler d’où j’étais parti, comment tout avait commencé. » Philip Roth (1933-2018) ou comment écrire sa vie d’homme et d’écrivain à partir des faits de l’existence, lorsqu’on a passé une vie entière à changer l’ordinaire en extraordinaire, comment faire le récit d’une vie et démêler la part de vrai de la fiction ? Tâche si difficile que Zuckerman lui répondra en guise d’épilogue qu’il a bien lu deux fois le manuscrit et que si c’était lui, il ne le publierait pas, tant son auteur s’en sort mieux, sans raconter sa vie avec exactitude. Pourtant, ce décalage-là entre l’auteur et son double en fait un récit aussi palpitant qu’un roman ; Roth évoque les rencontres formatrices, les années d’études, la vie de campus américain, les premiers flirts, les mariages successifs et naufragés dont le souvenir le hantera toujours, la naissance de sa carrière littéraire et le succès à la publication de son quatrième roman, Portnoy et son complexe. C’est aussi toute une analyse des travers de l’Amérique, en même temps que la présence permanente chez Roth de la judéité et du destin juif. On retrouve toutes les obsessions et les questions qui traversent tous ses romans : qu'est-ce qu'un Juif, un Américain, un auteur et surtout, qu'est-ce qu'un homme ? Éd. Folio/Gallimard, nouvelle trad. de l’anglais (États-Unis), Josée Kamoun, 265 p., 7,80 €. Corinne Amar.
Sam Szafran, Conversation avec Jean Clair et Louis Deledicq, Un gamin des Halles. Comment un gamin des rues, fils d'émigrés juifs polonais, sans éducation, sans un sou, solitaire, bifurque-t-il vers la peinture ? Par passion, par instinct de survie, sans doute. C’est une série d’entretiens qui fait entendre la voix de Sam Szafran, en 1989, dans son atelier en banlieue parisienne, à Malakoff. Qui était Samuel Szafran (1934-2019), interroge l’historien d’art Jean Clair. Né à Paris, il échappe de peu à la Rafle du Vel d'Hiv, son père est déporté dans les camps, il est un enfant caché. Encore tout jeune, il part pour l'Australie avec sa mère et sa sœur. Débrouillard, il s'essaie à tous les métiers, revient vivre au cœur de Paris, les Halles, le quartier de tous les émigrés, les sans patrie, prend ses distances avec sa famille. Il fréquente les habitués de Montparnasse, les cafés, habité d’une énorme soif d’apprendre, rencontre les poètes, les peintres qui lui font découvrir tout ce qu’il ne sait pas. Il raconte ainsi sa rencontre miraculeuse avec Giacometti qu’il aperçoit un soir de l’année 1961 au bar du Dôme, à Montparnasse alors que, se jetant à l’eau, le jeune peintre va vers lui et lui dit « Venez à mon atelier voir mes dessins ». Et Giacometti acceptera. « J’ai eu une évolution tardive, nous dit Szafran. Je n’ai commencé à entrevoir une certaine forme de maturité sur le regard qu’à partir de cinquante-cinq ans, pas avant. Avant, c’était un champ d’expériences. » Il travaille, dès les années 50, dans des ateliers de fortune et dans une pauvreté peu imaginable. D’abord, au fusain, parce que le fusain ne coûte pas cher, avant que d’être initié au pastel, à l’aquarelle. Son travail autour de l’abstraction évolue, ses liens se tissent avec la sculpture, le cinéma, la photographie. Et dans le retrait de son atelier parisien, naissent les toiles, apparaissent les obsessions, les sujets existentiels : les ateliers, les escaliers, les feuillages. Une très belle rétrospective lui est consacrée à Paris, au Musée de l’Orangerie jusqu’au 16 janvier 2023, Sam Szafran, obsessions d’un peintre. Éd. Flammarion, 122 p., 19 €. Corinne Amar.