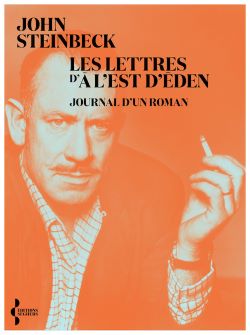Pierre Guglielmina est un traducteur des grands noms de la littérature anglo-saxonne (Bret Easton Ellis, Ernest Hemingway, Jack Kerouac, Francis Scott Fitzgerald, Norman Mailer, Richard Ford, Gordon Lish...). Il a été éditeur de littérature étrangère chez Calmann-Lévy. Il a traduit et commenté trois des quatre journaux de John Steinbeck : Dépêches du Vietnam aux Belles Lettres (2013), Jours de travail, les journaux des Raisins de la colère (2019) et Les Lettres d’À l’est d’Éden, journal d’un roman (2023) aux éditions Seghers.
Vous avez traduit et postfacé Les Lettres d’À l’est d’Eden - Journal d’un roman que John Steinbeck a écrit au moment de la rédaction du roman et qu’il destinait à son éditeur. Dans une lettre datée du 8 mai, Steinbeck dit de ces notes : « Elles me servent comme une sorte de terrain d’argumentation pour mon histoire » ou encore « Elles débarrassent l’écriture de tous les nœuds ou presque, avant que je me lance dans le livre. » La forme épistolaire lui permet de se mettre au travail, elle est une aide précieuse pour le processus d’écriture romanesque… En 2019, vous aviez traduit et préfacé un document semblable : Jours de travail - Les journaux des Raisins de la colère (Seghers). Quelles sont les similitudes ou les différences de ces deux documents qui éclairent l’écriture ?
Pierre Guglielmina : Il s’agit en réalité d’un détournement de la forme épistolaire. Pascal Covici, son éditeur, à qui Steinbeck s’adresse, est un correspondant fictif, un double hypothétique, puisque aucune de ces lettres ne lui sera transmise pendant la période de composition du roman. Jours de travail était un journal en bonne et due forme, à usage privé, tenu pendant l’écriture des Raisins de la colère. Entre les deux, on trouve le Journal russe écrit en 1947 et publié en 1948, compte-rendu de son voyage de quarante jours (!) en Union soviétique, en compagnie de son ami, le photographe Robert Capa. Et enfin, last but not least, il y a les Dépêches du Vietnam (que j’ai traduites et préfacées aux Belles Lettres en 2013), écrites pendant son séjour en 1966, et là encore fictivement adressées à Alicia Patterson, fondatrice du quotidien Newsday, décédée quatre ans plus tôt, en juillet 1963.
Ces quatre textes, datés respectivement de 1938-1941, 1947, 1951 et 1966, forment à mon avis un ensemble bien plus cohérent qu’il n’y paraît et constituent un relevé sismographique en quelque sorte de la pensée politique de Steinbeck. Non pas dans sa formulation idéologique, mais dans son élaboration profonde, liée à son activité d’écrivain et non à son activité « militante », elle, abondamment commentée, pour ne pas dire ressassée. C’est, je crois pouvoir le dire, un aspect encore inconnu de l’œuvre de Steinbeck, à la fois pour des raisons historiques — ces textes (à l’exception du Journal russe) ont été publiés de façon posthume — et pour des raisons moins avouables de paresse intellectuelle ou de conviction partisane — Steinbeck est un écrivain bien plus subtil qu’on ne l’a laissé entendre. À cet égard, l’édition récente de ses romans dans La Pléiade a donné lieu à une répétition « théâtrale » de clichés et de propos datés, mis au service d’une réflexion assez pauvre.
Ce qui me paraît très intéressant dans cette configuration, c’est l’axe dans lequel est placée l’écriture quotidienne du journal : vers une hypothèque sur l’avenir (la lecture éventuelle de Pascal Covici), vers une destinataire située dans le passé (l’égide d’Athéna-Alicia Patterson), vers un présent immédiat (Journal russe), vers un présent à jamais différé (Jours de travail n’était pas censé être publié). Ces quatre dimensions du temps, qui sont comme des qualités de la substance, ne doivent pas être confondues. Chacune a son propre rythme et sa propre fonction, même si toutes répondent à une exigence pratique fondamentalement identique, vous avez raison de le souligner : débarrasser l’écriture de ses nœuds. En 1953, Jack Kerouac écrivait : « Dénouer la langue du monde, voilà ce que je fais. » Vous avez aussi la formule d’une grande netteté de Georges Bataille : « Je ne peux pas considérer comme libre un être n’ayant pas le désir de trancher en lui les liens du langage. » Débarrasser l’écriture de tous les nœuds, dénouer la langue du monde, trancher le nœud gordien du langage, trois propositions convergentes (dans l’ordre de leur apparition chronologique au cours des années 1950), qui répondent à une oppression identique, liée à la désuétude de la forme romanesque, et à un temps pressant.
Disons pour anticiper que c’est vraiment le temps qui opère ce dénouement. Mais de quel temps est-il question ? Je reviendrai plus loin sur ces « axes » du temps et sur le rôle qu’ils jouent dans les différents journaux de Steinbeck. Le titre de Lettres d’À l’est d’Éden laisse peut-être entendre qu’il pourrait s’agir d’une correspondance, mais ce n’est pas du tout le cas. Ou alors c’est une correspondance avec soi-même.
Est-ce que traduire ces écrits présente des difficultés particulières ? Est-ce différent de la traduction d’un roman ?
P.G. La réponse à cette question est un peu compliquée. Je vais partir du cas qui nous occupe, les Lettres d’À l’est d’Éden, Journal d’un roman. La forme physique que prend ce journal est très intéressante : Steinbeck consacre au journal la page de gauche d’un grand cahier, la page de droite étant réservée à l’écriture du roman. Je dis, dans ma postface, que Steinbeck se considère comme un schizophrène heureux et combatif. Face à ce document hypothétique qui contiendrait alternativement le journal et le roman, le lecteur n’aurait pas d’autre choix que d’être lui-même schizophrène, heureux et combatif. L’écriture de ce cahier est une intégration de la lecture dans l’écriture. Le schéma classique, rebattu, est le suivant : lecteur heureux et passif, écrivain malheureux et combatif. C’est la séparation achevée dont on trouve des illustrations à n’en plus finir. Ou, si vous voulez, l’erreur de la légende douloureuse, quand l’humanité croyait pouvoir consoler le poète. La « schizophrénie heureuse » renverse ce schéma en intégrant la lecture à l’écriture et en permettant du même coup de se débarrasser de la passivité et du malheur. Pourquoi ? Parce que, écrit Steinbeck, « À l’est d’Éden n’est pas une romance, mais une guerre qu’il va falloir mener. » Comment ? En donnant la parole au lecteur qu’est Steinbeck et en mettant tout lecteur en position de pouvoir comprendre les enjeux pratiques, réels, de l’écriture du roman. Au lieu de se complaire à la lecture d’une romance, le voilà sommé d’envisager la guerre en cours. C’est fait de façon assez désinvolte, avec une apparente confusion et dépréciation de soi, doublées en sous-main d’une détermination de fer. C’est bien sûr, pour Steinbeck, une façon de se mettre en forme, tous les matins, pour mener à bien cette guerre contre l’hypnose (la sienne pour commencer), qui est toujours le seul roman qui vaut la félicité d’être écrit. Mais c’est aussi une invitation POUR TOUS ET POUR PERSONNE à lire les Lettres d’À l’est d’Éden en ayant en tête, en imaginant, cet autre côté du cahier, comme si le roman était encore à faire et non le monument qu’on a désormais sous les yeux.
La difficulté de ces journaux — mais je dirais plutôt que c’est un défi très stimulant — tient au caractère hétérogène du texte qui oscille sans cesse du dehors au dedans, de l’intense au trivial, de l’émotif au cérébral, de l’intime au politique, de l’observation à la spéculation, de la concentration à la distraction, du doute à la confiance. Avec, au passage de l’un à l’autre, des changements intempestifs de rythme, de vocabulaire, de conjugaison, qu’il est nécessaire de suivre au plus près pour obtenir en français l’effet recherché par Steinbeck : se défaire, comme il le dit lui-même, de toute obséquiosité envers le roman. L’anglais plus rapide est aussi plus naturellement irrévérencieux. Donc en gardant toujours à l’esprit qu’on a affaire à une guerre, non à une romance. C’est la tonalité commune aux quatre journaux.
Dans ce journal de bord tenu au cours de l’année 1951, l’écrivain confie notamment sa crainte de mettre un terme à l’écriture du roman, livre ses réflexions sur la réception du livre et écrit : « Comme tu le sais, le roman est tombé face à l’attaque féroce de la non-fiction… »
P.G. Le déclin du roman face à la poussée hégémonique de la non-fiction est, semble-t-il, la cause invoquée par Steinbeck, mais la phrase que vous citez se prolonge par la suivante : « C’est dû largement au fait que le roman n’a pas changé depuis très longtemps. » L’attaque féroce de la non-fiction n’a produit de tels effets qu’en raison de la paresse des romanciers et, plus précisément, de l’obséquiosité envers le roman que j’évoquais à l’instant. Cependant, bien plus tôt dans le journal, n homme puisse tirer de ce livre autant qu’il y apporte » (lettre du 22 février 1951). Et quelques lignes plus bas, il ajoute : « Je crois qu’il serait plus approprié de l’appeler non pas un roman, mais une histoire. Et alors même qu’il a une forme très resserrée, j’ai l’intention de lui conférer l’absence de forme propre au récit historique. L’histoire n’est pas l’absence de forme, mais il faudra une [vision] longue et une tournure philosophique de l’esprit pour en voir le motif. » Nous voilà transportés en quelques lignes vers une certaine réactivation du roman philosophique du XVIIIe siècle, où le lecteur tire du livre autant qu’il y apporte. Ce rapport de la lecture et de l’écriture est le cœur du Journal d’un roman. Idéalement, Steinbeck veut un lecteur actif, à la tournure d’esprit philosophique. Mais si le lecteur est illettré, dit-il, il « peut prendre plaisir à lire l’histoire de façon superficielle et saisir aussi autre chose de façon inconsciente. » On est à mille lieues d’une littérature édifiante, didactique, dont Steinbeck entend bien se détacher définitivement.
Le récit historique, dans son absence de forme, va pouvoir vagabonder librement et seules la vision longue et la tournure d’esprit philosophique permettront de discerner le motif du livre. Histoire et motif sont distincts. J’aurais tendance à penser que le véritable motif du livre n’a pas tant à voir avec l’histoire de la Vallée de Salinas au début du XXe siècle qu’avec la période contemporaine de la rédaction du roman, celle du début de la Guerre froide (notion qui a toujours inspiré une suspicion profonde à Steinbeck). Toujours au début du journal, il donne un aperçu de ce motif inapparent d’À l’est d’Éden : « Ce matin, le plan Schuman a entamé son parcours pour être signé. C’est, je crois, le premier signe de l’organisation de l’avenir — l’inauguration du gouvernement supra-étatique. […]. À présent, note ma prophétie – le prétendu système communiste s’effondrera et se détruira dans d’horribles guerres civiles parce que ce n’est pas un système qui peut fonctionner durablement. Il explosera du fait de ses propres défauts. D’un autre côté, le plan Schuman est un système qui peut fonctionner de manière durable. Les hommes d’affaires si inquiets à propos du statu quo n’ont pas grand-chose à craindre du communisme. Le plan Schuman est le truc qui va changer le monde. Je ne crois pas que l’Amérique puisse entrer en compétition avec cette nouvelle forme de cartel sponsorisé et contrôlé. Nous serons forcés de le combattre ou de le rejoindre, et si nous le rejoignons, le gouvernement mondial sera établi. Si nous le combattons, nous perdrons. » C’est, à mon sens, cette « prophétie » qui éclaire le recours au thème biblique de Caïn et Abel. Prophétie de l’effondrement du système communiste dans des guerres civiles et de la reddition de l’empire américain au gouvernement mondial, qui pourrait d’ailleurs trouver ces jours-ci une illustration inattendue et décalée dans le temps. Mais le temps prophétique n’est pas le temps chronologique. Bibliquement, nous sommes aujourd’hui plus que jamais à l’est... d’Éden. Steinbeck a employé le terme d’obséquiosité, mais on pourrait sans hésiter lui substituer aujourd’hui celui, synonyme, de servilité parce que la question se pose désormais en des termes aggravés : le roman, dans son déferlement programmé, ne survit-il pas la plupart du temps comme confession d’une servitude volontaire ?
Pensez-vous que la rédaction de ces Lettres a accru l’aspect recherche de son travail, l’a conduit à se poser davantage de questions ?
P.G. Steinbeck dit d’À l’est d’Éden que c’est le roman auquel il a réfléchi le plus longtemps. Lettres d’À l’est d’Éden, Journal d’un roman ne constitue pas tant, je crois, un laboratoire de recherche qu’une sentinelle perdue, en faction dans une position dangereuse, exposée. À l’époque de l’écriture des Raisins de la colère, il écrit à son ami Carlton Sheffield, le 13 novembre 1939 : « Je dois prendre un nouveau départ. J’ai travaillé sur le roman… aussi loin que je pouvais l’emporter. […]. Et je ne connais pas la forme du nouveau, mais je sais qu’il y a une chose nouvelle qui sera adéquate et façonnée par la nouvelle pensée. » Il est toujours dans le même état d’esprit en 1951 et la tension croissante qu’on enregistre au cours du Journal d’un roman est le reflet du danger auquel il s’expose. Écoutez ce qu’il dit au tout début du journal, le 29 janvier 1951 : « Dans une solitude absolue, un écrivain tente d’expliquer l’inexplicable. Et s’il est assez chanceux et si le moment est propice, une toute petite quantité de ce qu’il essaye de faire exister advient – presque rien. S’il est un écrivain assez sage pour savoir que ce n’est pas possible, alors il n’est pas écrivain du tout. Un bon écrivain travaille toujours à faire advenir l’impossible. Il y a un autre genre d’écrivain qui limite son horizon et concentre son esprit comme on abaisse le canon de son fusil. Et en renonçant à l’impossible, il renonce à écrire. Que ce soit heureux ou malheureux, ce n’est pas ce qui m’est arrivé. Le même effort aveugle, la même tension, le même essoufflement continue de m’animer. […]. C’est un désir qui a du mal à s’éteindre. »
Les Lettres d’À l’est d’Éden sont le journal de ce désir qui a du mal à s’éteindre. En passant, la « braise qui rougit sous la cendre » est une métaphore de l’écriture chez Francis Scott Fitzgerald.
Ces Lettres – qui explorent les structures romanesques – ne sont-elles pas à l’image de ses outils de menuisier et des objets qu’il se plaît à réparer, à construire ou à confectionner ? Il écrit aussi qu’il veut que son livre « réunisse toutes les formes, toutes les méthodes, toutes les approches… »
P.G. La caisse en bois sculpté que fabrique Steinbeck pour se distraire ou se détendre, pendant l’écriture du journal et du roman, afin d’y placer les cahiers d’À l’est d’Éden et de l’offrir à Pat Covici, est moins un mausolée qu’un cénotaphe, un tombeau vide élevé à la mémoire d’un mort. Et le mort, c’est le roman terminé. « Moi, je me fiche éperdument d’un livre une fois qu’il est terminé. L’argent et la célébrité qui en découlent n’ont aucun lien avec le sentiment qu’il m’inspire. Le livre meurt de sa vraie mort quand j’en écris le dernier mot. J’en éprouve une légère tristesse et j’enchaîne sur un nouveau livre qui, lui, est vivant. Sur l’étagère, l’alignement de mes romans me fait songer à des cadavres bien embaumés. Ils ne sont ni vivants ni miens. Je n’ai aucun chagrin pour eux parce que je les ai oubliés, oubliés au sens le plus véridique », écrit-il le 22 mai 1951. Cette mise en boîte, sur laquelle il sculpte des caractères en hébreu, est une mise en scène qui vise, à la fois, à épaissir le mystère et à donner certaines clés pour la compréhension de son propos. D’une certaine façon, le journal redonne vie au livre. Il ne s’achève pas vraiment, la dernière lettre annonce qu’il devrait être assez près de la fin et que ce sera une rude journée. Tout est laissé en suspens et je ne crois pas que ce soit un hasard. Voyez comment prend fin Jours de travail, les journaux des Raisins de la colère : « Le soleil a disparu de nouveau. N’ai pas eu de nouvelles de Carol. J’espère qu’elle ne se sent pas aussi seule qu’elle l’était. Elle était au plus bas. Je crois que je vais laisser ce livre maintenant. » Et le Journal russe : « Nous savons que ce journal ne plaira ni à la gauche ecclésiastique ni à la droite populaire. Celle-là dira qu’il est antirusse, celle-ci qu’il est prorusse. Il est superficiel, c’est certain, comment pourrait-il en être autrement ? » Et enfin les dernières lignes de la dernière des Dépêches du Vietnam : « L’imagination va être attirée vers l’Ouest comme toujours et le nouvel Ouest, c’est l’Asie. […] L’Est est devenu l’Ouest. […] L’Orient est devenu l’Occident. » Chaque fois, c’est une temporalité distincte qui dicte la fin du journal.
Je reviens un instant sur ces « axes du temps » dont je parlais plus tôt et qui me paraissent très visibles et lisibles dans les journaux de Steinbeck. Que veut-il dire quand il proclame qu’il a oublié ses livres, qu’il les a « oubliés au sens le plus véridique » ? Rien de ce que le sens commun pourrait nous apprendre. Mais plutôt le fait que ses livres ont traversé une forme d’oubli très spécifique. Au lieu de s’en tenir aux illusions d’un passé harmonieux reconstruit, aux faux-semblants de la mémoire volontaire et même aux avancées de la mémoire involontaire. Quatre axes ou dimensions du temps (hypothéqué sur l’avenir, orienté vers le passé, immédiat, différé à jamais) qui façonnent précisément cet oubli, dans l’assemblage distinct, le dosage différent, qui caractérise chacun des journaux. L’oubli véridique, c’est cet oubli qui a traversé la mort elle-même et que symbolise le tombeau vide. Représenté avec une grande ironie par cette boîte en bois, sculptée de quatre caractères en hébreu, enfermant le roman « mort de sa vraie mort. » Cette « vraie » mort qui provoque « l’oubli véridique » donne accès, une fois la mort traversée, au nouveau livre qui intégrera à son tour « toutes les formes, toutes les méthodes, toutes les approches. » Passées, présentes et à venir. L’art du roman dans le temps de la prophétie et de la résurrection.
Steinbeck évoque également sa famille, le quotidien, l’actualité politique, et son intérêt presque obsessionnel pour la qualité de ses crayons…
P.G. Sur les allusions à sa famille, à la vie quotidienne et à l’actualité politique, il faut remarquer qu’elles semblent dictées essentiellement par le thème de Caïn et Abel : le livre dédié aux deux fils, les problèmes récurrents de l’un, le bonheur sans nuage de l’autre, la simplicité du mode de vie quasi biblique, les mondanités à contrecœur, les questions politiques sur lesquelles Steinbeck prononce des sentences prophétiques. Quant à l’intérêt obsessionnel, liturgique, pour les crayons et leur taille, je ne peux que renvoyer à l’étude magistrale de Pierre Assouline dans un numéro récent de L’Express.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur les Hamilton (la famille maternelle de Steinbeck) et les Trask (famille voisine) dans À l’est d’Eden, et en quoi cette histoire dépasse le cadre de la vallée de Salinas ?
P.G. « J’utilise la Vallée de Salinas comme microcosme de la nation entière, » déclare Steinbeck. Je dirais que son propos dépasse de loin la nation entière et concerne la civilisation née de la Bible. Je ne connais pas bien l’histoire de la famille maternelle de Steinbeck, mais la famille Trask, nom inventé par lui, m’a intrigué. D’autant plus que le premier nom inventé pour cette famille était Canabale, lequel sonne, quand on le prononce en anglais, comme CaïnAbel et aussi cannibal. Il y renonce parce qu’il ne veut pas que le double ou triple sens soit trop apparent et pour que son « lecteur ne voie pas ce qui lui arrive jusqu’à ce qu’il se retrouve piégé. » Le nom de Trask est lui-même énigmatique puisqu’il condense Trace (la trace) et Task (la tâche), dont on pourrait dire qu’elles sont la traduction et la transmission du signe de Caïn : à la fois la trace imprimée dans la chair et la tâche imposée à lui et à sa descendance. Steinbeck plonge des racines profondes dans la civilisation biblique et même prébiblique. Du cannibalisme à la mort de Dieu, en passant par le banquet de l’eucharistie.
Le lecteur de ce « journal-correspondance » découvre comment naît l’ajustement du titre et comment s’impose le choix final qui s’inspire d’un passage de la Genèse.
P.G. « Caïn se retira de la présence de Yahvé au pays de Nod, à l’est d’Eden. » Comment l’homme se retire-t-il d’un retrait, d’une présence à éclipses de Yahvé ? Les titres précédents étaient La Vallée de Salinas, Ma Vallée, puis Le Signe de Caïn. À l’est d’Éden, cette vallée qui s’étend désormais à la Terre entière, est l’orientation des trois premiers titres. Ma Vallée de Salinas sous le Signe de Caïn. Si l’on pense à l’évocation du gouvernement mondial au tout début du Journal d’un roman, si l’on pense à ce qu’il dit à la fin des Dépêches du Vietnam sur l’Orient devenu Occident et donc l’Occident devenu Orient, la « prophétie » de Steinbeck prend une consistance étonnante et sa pensée acquiert une cohérence décisive. Ce motif inapparent d’À l’est d’Éden, qui ne s’éclaire qu’à la lecture de ces Lettres d’À l’est d’Éden, opère une résurrection du roman, raison pour laquelle je parlais d’une « hypothèque sur l’avenir » pour définir la temporalité spécifique du journal. Tout cela est d’une très grande subtilité et dénote une connaissance profonde de l’Ancien Testament et des Évangiles.
Quelques mots sur les différentes acceptions du terme hébreu mal translittéré « Timshel » [qui vient du verbe Limshol à l’infinitif, régner] sur lequel se termine le roman et le dernier soupir d’Adam Trask, et pour lequel Steinbeck s’interroge dans ses lettres ?
P.G. Du mot « Timshel », Steinbeck dit qu’il est « l’offrande du libre-arbitre, la responsabilité individuelle et l’invention de la conscience. » Et qu’il « a été traduit de façon variable par “Tu règneras”, “Tu dois régner” et “Il se peut que tu règnes”. » La question est donc celle du royaume et de la souveraineté sur soi-même, et des modalités temporelles et extratemporelles que cette dernière peut adopter. S’agissant des modalités temporelles, Steinbeck écrit : « Il faudra que j’aie le verbe entier avant de pouvoir finir, depuis l’infinitif jusqu’au passé, subjonctif, passé composé et futur. » Je vais supposer que l’infinitif, ici, n’est pas le mode temporel, mais le mode impersonnel — comme condition d’accès à la pointe de l’individuel. Et que les quatre temps qui suivent sont les « axes du temps » de ses journaux : le passé est le temps orienté vers le passé, le subjonctif est le temps hypothéqué sur l’avenir, le passé composé est le présent immédiat, le futur, le présent à jamais différé. En me souvenant de ce que dit Proust du style de Flaubert : « J’ai été stupéfait, je l’avoue, de voir traiter de peu doué pour écrire un homme qui, par l’usage nouveau et personnel qu’il fait du passé défini, du passé indéfini, du participe présent, de certains pronoms et de certaines prépositions, a renouvelé presque autant notre vision des choses que Kant, avec ses Catégories, les théories de la Connaissance et de la Réalité du monde extérieur. » Et de ce qu'annonce Nietzsche dans Le Crépuscule des Idoles : « Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons encore à la grammaire… » En bousculant la grammaire et les conjugaisons, Steinbeck entend moins se débarrasser du Dieu de la métaphysique que ranimer, dans un temps extatique, illuminé, la souveraineté sur un royaume d’un autre ordre, plus intime, plus secret, plus noble.
Pour finir, j’aimerais que vous commentiez cette phrase du 19 juin 1951 : « Je me divise en trois personnes. » Dans la postface, vous parlez notamment du « mouvement trinitaire du journal. »
P.G. Au milieu de l’année 1951, au milieu de son journal, après une nuit sans sommeil, « une de ces nuits de découverte », Steinbeck écrit ces quelques lignes qui sont donc le cœur du cœur du livre : « Conjecture. Je vais tout te raconter en détail, si ça t’intéresse. Je me divise en trois personnes. Je sais à quoi elles ressemblent. L’une spécule, l’autre critique et la troisième essaie d’établir les corrélations. D’ordinaire, ça tourne au pugilat, mais il en sort tout le travail de la semaine. Et cela se poursuit dans mon esprit sous la forme d’un dialogue. C’est une expérience étonnante. Dans certaines circonstances, ce pourrait être un de ces symptômes schizophréniques, mais en tant que technique d’écriture, je trouve que ce n’est pas mal du tout. » Avec ces trois personnes de la Trinité qui n’en font qu’une, Steinbeck sait à quoi s’en tenir. Le Père spécule dans le temps long du roman, le Fils critique dans celui, bref et quotidien, du journal, le Saint-Esprit établit les corrélations dans le temps suspendu de la lettre en vol, dans ce temps différé de l’accomplissement de l’écriture du journal et du roman. L’écrivain se faisant schizophrène, heureux et combatif est une imitation du Christ. Pour rire.
À la fin du Journal d’un roman, on trouve la dédicace d’À l’est d’Éden, adressée à Pascal Covici. On croirait lire « Jésus devant Pilate » dans un évangile apocryphe. Lisez-la. Celui que les « Pilates » du pilon, en somme, prennent pour le roi des Juifs ne cesse de répéter que son royaume n’est pas de ce monde.
John Steinbeck - Journaux
1. John Steinbeck, Journal d'un roman. Seghers, 2023 (Traduction et postface de Pierre Guglielmina)
2. John Steinbeck, Jours de travail. Seghers, 2019 (Traduction et préface de Pierre Guglielmina)
3. John Steinbeck, Dépêches du Vietnam. Les Belles Lettres, 2013 (Traduction et préface de Pierre Guglielmina)
4. John Steinbeck - Journal russe. Gallimard, 2022 (Traduction de Philippe Jaworski)