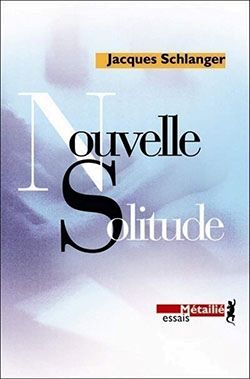Né en 1930 en Allemagne, Jacques Schlanger a fait ses études à Paris, à la Sorbonne. Il émigre en Israël en 1968, et enseigne la philosophie à l'Université de Jérusalem. Il rédige ses articles en hébreu, mais écrit ses livres en français.
Passer quelques heures avec Jacques Schlanger, à converser de philosophie, d'histoire, de peinture, d'écriture, de la mort et de la vie, de soi et de l'autre, fut un grand plaisir. Cet admirateur d'Épicure, qui aime tout autant en Husserl la patience et l'obstination de la pensée, voit en la philosophie une « discipline intérieure, une manière d'être et de se situer dans le monde ». Il part souvent de l'événement autobiographique pour alimenter sa réflexion.
Jacques Schlanger est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Solitude du penseur de fond, Guide pour un apprenti philosophe, Sur la bonne vie, Un art, des idées et Apologie de mon âme basse. Il nous parle de son dernier livre Nouvelle Solitude paru aux éditions Métailié (2006).
Qu'est-ce qui vous a amené à la philosophie ? Vous avez commencé par les mathématiques …
Jacques Schlanger : J'ai beaucoup aimé les mathématiques, le jeu de la liberté dans le cadre de règles qu'on s'impose à soi-même, dans un véritable plaisir de l'esprit. Mais très tôt je me suis rendu compte que je ne serai jamais le mathématicien que j'aurais aimé être. Après un bref détour par l'histoire, plus particulièrement par l'histoire des religions, j'ai découvert avec joie la philosophie et je m'y suis arrêté. Les mathématiques, c'est apprendre à bien penser; la philosophie, je le pensais alors et je le pense encore, c'est avant tout apprendre à bien vivre. En cela, je me sens proche de Socrate et de ceux qui le suivent. La philosophie est pour moi une discipline intérieure, une manière d'être et de se situer dans le monde, une relation personnelle de soi à soi et de soi au monde. Être philosophe, c'est avant tout oser poser des questions, ne rien prendre comme allant de soi, savoir prendre distance de soi et se regarder être, se demander quelle est la bonne vie, la vie qui vaut la peine d'être vécue, et s'efforcer de la vivre. Selon une fameuse parole de Maître Eckhardt, le philosophe ne doit pas être un Lesemeister, un maître de lecture, mais un Lebemeister, un maître de vie.
L'ouvrage que vous venez de publier, Nouvelle Solitude, est une nouvelle version de Solitude du penseur de fond (Critérion, 1990) …
Jacques Schlanger : Nouvelle Solitude est une version à la fois allégée et augmentée de ce texte, qui, je dois l'avouer, n'a pas eu le sort que j'en espérais. J'ai retrouvé ce texte, écrit il y a 16 ans, qui n'a été lu que par quelques amis, je l'ai repris, retravaillé, élagué et étoffé, compte tenu de ma propre transformation au long de ces années. Je me sens plus à l'aise maintenant avec la nouvelle version qu'avec l'ancienne, mais je dois dire que cette première version a été pour moi un moment important dans mon développement personnel, un nouveau regard jeté sur mon entreprise philosophique. C'est là qu'a commencé pour moi ce que j'ai nommé par la suite ma philosophie de chambre.
Vous parlez en effet de « philosophie de chambre » dans votre livre…
Jacques Schlanger : Dans Apologie de mon âme basse, j'ai longuement parlé de ce que j'entends par « philosophie de chambre », par opposition à la grande philosophie, la philosophie « symphonique » : une manière personnelle, intime, de philosopher. Je suis devenu un philosophe de chambre, à la manière du musicien de chambre qui joue sa musique dans un espace restreint. Mais s'accepter comme philosophe de chambre demande un certain courage, puisqu'il s'agit alors de quitter la grande philosophie, la philosophie symphonique, la philosophie des grands thèmes, des grandes questions, pour aller vers les petites choses, les choses de la vie de tous les jours, vers la philosophie de voisinage, de ce qui est autour de nous. J'ai beaucoup d'admiration pour les grands hommes de la philosophie, mais maintenant je me suis installé dans ma chambre, et c'est de l'intimité de ma chambre que j'observe le monde, que je regarde ce qui se passe en moi et autour de moi, et que j'en fait part à ceux qui veulent bien s'y intéresser. Cette philosophie privée, j'en suis persuadé, du fait justement qu'elle est privée, nous touche plus directement, nous interpelle plus en profondeur, que la philosophie symphonique publique.
Quant à l'opposition « penseur de fond » et « penseur de surface »…
Jacques Schlanger : Je me considère comme un penseur de fond plutôt qu'un penseur de surface. Je ne couvre pas tout le terrain, je m'efforce plutôt d'aller au fond de certains aspects de ma pensée. Pour éclairer cette distinction, que l'on pense à Husserl comme penseur de fond et à Nietzsche comme penseur de surface. Je ne veux pas dire par là que Nietzsche est un penseur superficiel, mais plutôt qu'il s'attaque surtout à la surface des choses, à leur apparence, à la manière du pivert qui s'acharne sur l'écorce vermoulue pour y trouver sa proie, tout en scrutant sans cesse ce qui se passe autour de lui. De son côté, Husserl le penseur de fond avance lourdement, lentement, en profondeur : il se demande qu'est-ce qu'un son, qu'est-ce qu'écouter, que perçoit-on et comment. Il a le regard myope de celui qui ne voit que de près, qui enfonce son regard dans l'objet de sa recherche. Il me fait penser à ces peintres qui consacrent des années à un même thème. J'ai été dernièrement à Bologne, à l'exposition permanente des œuvres de Morandi. À l'âge de trente ans, il s'est mis à peindre des bouteilles, et il a continué jusqu'à sa mort. Il n'a pas fait que cela, mais c'est à ces bouteilles qu'il a consacrées l'essentiel de son œuvre. Il peignait toujours les mêmes bouteilles, avec quelques vases autour, posées sur une table de son atelier. Explorant volontairement un territoire réduit, il expérimentait les limites de la représentation ; il jouait avec la disposition de ces quelques objets, leur arrangement, la lumière qu'il projetait sur eux, en en montrant les subtiles variations. Morandi était un peintre de fond, et Matisse aussi, et d'autres encore, peintres d'un même motif en en creusant le sens. Il en est de même pour Husserl, à la recherche d'une meilleure perspective sur l'objet de sa recherche.
Je ne suis pas un Husserl, mais je le trouve admirable, à cause justement de cette patience, de cette obstination dans la pensée. Il ne construit pas une forteresse, il en établit les fondements. Et moi aussi, dans la mesure de mes moyens, je creuse en moi-même, pour y trouver un fond sur lequel construire, et aussi pour établir un lieu de passage afin de prendre contact avec autrui. C'est là qu'interviennent les éléments autobiographiques de mon entreprise.
Les événements autobiographiques sont pour vous le point de départ d'une réflexion…
Jacques Schlanger : En effet, je fais usage de moi, de certaines anecdotes de ma vie, de certaines de mes manières d'être, pour communiquer avec autrui, pour me révéler à lui, pour être en contact avec lui. Je ne me raconte pas pour le plaisir narcissique de m'exposer, mais pour créer un lien entre moi et mon lecteur. Je creuse en moi-même le fond sur lequel je m'appuie pour faire vibrer mon lecteur à l'intérieur de lui-même. En me voyant être ce que je suis, il me comprend, et cela parce qu'il se comprend : mon « particulier » porte en soi la trace de notre « universel », et cet « universel » qu'il découvre en moi, il le lie à son propre « particulier » ; c'est ainsi qu'il se retrouve en moi, et que je me retrouve en lui. J'aimerais donc qu'on considère ce que je raconte de ma vie, non pas comme une confession ou une complaisance, mais comme autant d'ouvertures sur chacun de nous-mêmes, sur notre vie, sur notre manière d'être, d'agir, de réagir. C'est en ce sens que je considère ma vie comme exemplaire, car toutes les vies humaines sont exemplaires dans la mesure où chacune d'elles exprime à sa manière l'humanité toute entière. Je me cite : « Ma vie est une vie, c'est-à-dire la vie ; ma pensée est une pensée, c'est-à-dire la pensée ; mon désir est un désir, c'est-à-dire le désir ; et ainsi de suite. Voilà qui fonde mon usage de moi, ton usage de toi, l'usage que chacun fait de soi. En examinant ma vie, je retrouve la vie des autres; en partant de ma vie, j'entre en relation avec la vie des autres. » (p.9).
Ainsi, la manière précise dont j'ai perdu la foi et l'anecdote qui s'y rattache n'est pas intéressante en elle-même. Ce qui m'importait c'est de faire comprendre ce que j'entends par « vivre ma croyance en Dieu », par « vivre en ayant cesser de croire en Dieu », comment un changement si radical peut-il arrivé : bref un ensemble de questions qu'un grand nombre d'entre nous se posent ou se sont posées. Changer de croyance, de quelqu'ordre que soit cette croyance, qu'elle soit religieuse, sociale, politique, idéologique, voilà le vrai problème – et ce qui m'est arrivé personnellement n'est qu'une illustration, un exemplum, sans pour autant être un modèle à suivre. Je n'ai livré l'histoire de ma mécréance qu'à partir de ma réflexion sur le problème plus général de la croyance et du changement de croyance.
Dans votre chapitre « Espérer », vous parlez du rapport au temps, en évoquant la manière dont les Stoïciens et les Épicuriens vivent le présent …
Jacques Schlanger : Il faut d'abord que je vous dise que je suis un grand admirateur d'Épicure, je dirai même qu'il est mon philosophe favori, celui avec lequel je me sens le plus à l’aise. Pour en revenir à votre question, aussi bien les Stoïciens que les Épicuriens vivent intensément le présent, mais ils le vivent d'une toute autre manière. Pour le Stoïcien, tout est déterminé d'avance, le présent est une suite nécessaire du passé, et le futur est un complément nécessaire du présent : une suite nécessaire de causes et d'effets. Par contre, pour l'Épicurien, le monde est en permanente transformation aléatoire ; il vit dans un état d'incertitude, et c'est dans un tel monde qu'il doit apprendre à bien s'intégrer. Alors que le Stoïcien doit se faire à la nécessité qui s'impose à lui, l'Épicurien accepte le poids de sa liberté. Mais tous les deux vivent entièrement au présent, surtout dans leur relation à leur propre mort, dans le sentiment de son inéluctabilité. C'est pourquoi j'ai intitulé mon dernier chapitre « Mourir/vivre », c'est-à-dire vivre à l'ombre lumineuse de la mort.
Pouvez-vous commenter cette phrase qu'on trouve dans « Mourir/vivre » : « je vis à l'ombre de ma mort » ?
Jacques Schlanger : Effectivement, je pense beaucoup à ma mort. Le fait de savoir profondément que je vais mourir organise ma vie, me sert de cadre de vie, me rassure même d'une certaine manière dans ma vie. La seule chose définitive, c'est que je vais mourir, et en soi ce n'est pas dramatique : voir la mort comme un point fixe de notre vie relativise les drames de la vie. Ne nous prenons pas trop au sérieux, nous allons tous mourir. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas vivre comme il faut, agir comme il faut, jouir de la vie comme cela me convient, mais cette pensée de ma mort me calme, me fait voir les choses à leur juste proportion. Plus encore, l'inéluctabilité de la mort me sert de rempart contre certaines lâchetés de la vie : il y a des limites d'abaissement, d'avilissement, d'indignité, que la mort inéluctable nous permet de ne pas franchir. Il faut à la fois ne pas faire trop attention à la vie, et y faire très attention. On est là tout le temps dans une sorte de va-et-vient, à la recherche du bon équilibre de vie, en prévision de la mort. En ce sens, l'ombre de la mort dans laquelle je vis me permet une plus grande liberté, et même des choix radicaux, parce que je sais que cela ne sera pas pour toujours.
J'ai bien sûr une appréhension, celle de la déchéance, « le naufrage de la vieillesse ». C'est cela qui fait vraiment peur, non pas le fait de mourir, mais la voie qui nous y mène. Les gens âgés voient beaucoup de gens âgés qui meurent mal, dans la douleur, dans la démence, dans les excréments : la mort est là une véritable délivrance. Le rêve : mourir, ni trop tôt, quand la vie vaut encore la peine d'être vécue, ni trop tard, quand la vie n'est plus qu'une honte à supporter.
Dans « Espérer » vous écrivez : « La sagesse se présente comme une manière de ruser avec ce qui nous arrive en s'en accommodant … Espérer, c'est rester enfant, c'est croire qu'on peut recevoir ce qui ne nous revient pas, croire qu'il est possible de plaire aux puissances. Le sage sait que cela n'est pas possible… » De quel sage s'agit-il ?
Jacques Schlanger : Je rêve de sagesse, j'aimerais être sage, mais je sais que je ne le suis pas, et que je ne le serai jamais. J'admire la lucidité du sage, sa froideur même, son acceptation, sa résignation, mais je n'arrive pas à m'y faire. Trop de choses s’emmêlent en moi, l'espoir, le désespoir, le désir, la crainte, la haine, l'amour, autant de traits dont se dispense l'in-humanité du sage, autant de traits qui marquent notre humanité. Le sage ruse avec ce qui lui arrive pour chercher à le dominer ; et nous autres, restés enfants, nous nous débattons avec ce qui nous arrive, en faisant de notre mieux et en espérant que la chance soit avec nous. Un garde-mobile a sauvé ma vie, et mon ami Chimy est mort à Auschwitz : je n'arrive pas à m'en sortir.
(FloriLettres n°74, juin 2006 )