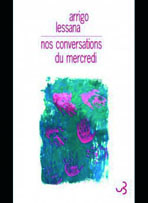RÉCITS
Vivian Gornick, La femme à part. Traduction de l’anglais (États-Unis) Laetitia Devaux. Dans Attachement féroce paru aux États-Unis en 1987 et traduit en français par les éditions Rivages en 2017, Vivian Gornick et sa mère septuagénaire arpentaient Manhattan et les souvenirs de leur passé dans le Bronx. Le livre dévoilait leur relation complexe et la quête d’émancipation de la fille. Dans ce deuxième ouvrage autobiographique, l’écrivaine et critique littéraire, qui se définit comme « une marcheuse de la ville qui nourrit le courant perpétuel de cette foule perpétuelle imprégnant la créativité. », poursuit ses déambulations new-yorkaises. Adolescente déjà, elle sillonnait Manhattan de long en large, rêvant de s’installer sur West End Avenue, fief des intellectuels et des artistes. « Je ne me suis jamais sentie moins seule que seule dans une rue bondée. Là, je parvenais à me représenter ce que j’étais. » Le fourmillement, l’énergie propre à une grande ville lui sont indispensables. Elle sait qu’à tout moment, elle peut se reconnaître dans cette foule, capturer mille indices d’humanité dans ces visages, ces voix. Comme un fil conducteur, ses rendez-vous hebdomadaires tout à la fois stimulants et déprimants de lucidité avec son ami gay Léonard, un autre marcheur solitaire à l’esprit aussi incisif que le sien, ponctuent son récit et soulignent l’importance de leurs affinités. « L’image de soi que chacun projette sur l’autre est l’image mentale que nous avons de nous – celle qui nous permet de nous sentir complet. » Ses déplacements dans la ville épousent les mouvements de sa conscience, tracent des lignes entre passé et présent, dessinant une véritable cartographie de ses questionnements et de ses conflits intérieurs. Vivian Gornick convoque ainsi pêle-mêle sa mère au désespoir envahissant, sa peur de l’échec, son exigence intellectuelle, son engagement féministe, les écrivains qui ont compté, ses amours contrariés par cette « membrane invisible » séparant les hommes et les femmes « assez fine pour être traversée par le désir, suffisamment opaque pour entraver la communion humaine. », l’amitié ou la vieillesse. Infatigablement, elle sonde notre étonnement face à l’existence. « Qu’est-ce que soi ? Où est-ce ? Comment poursuit-on ça, y renonce-t-on, le trahit-on ? » Éd. Rivages, 200 p., 17,80 €. Élisabeth Miso
Arrigo Lessana, Nos conversations du mercredi. « Dis à Angelo que je lui fais confiance, il trouvera sa voie. Dis-lui qu’il faut partir de ce qui est présent dans la vie. Dis-lui de s’appuyer sur les choses qu’il a à faire, et sur celles qu’il a envie de faire, aussi. Dis-lui de dire oui à ce dont il a envie. Tu lui diras, n’est-ce pas ? », a demandé Charlotte à Arrigo Lessana, son père, avant de mourir. Chaque mercredi Arrigo Lessana a à cœur d’honorer cette requête. Chaque mercredi, il accueille son petit-fils Angelo, âgé de 13 ans et son nouveau livre, délicate réflexion sur la transmission, sur les récits et les mystères qui façonnent l’héritage familial, est né de leurs conversations. Tous deux ont en commun de s’intéresser aux mécanismes, Angelo veut être codeur et concevoir des algorithmes, le romancier a été chirurgien du coeur sans doute pour le « plaisir de faire, d’accomplir, de remettre en ordre, de reconstruire, et que ça marche.» Décryptage des hiéroglyphes par Champollion, littérature, phénomène de brouillard en Romagne, fragments d’un voyage à Londres et à Cambridge, histoire familiale, la diversité de leurs échanges illustre bien leur curiosité respective. Le grand-père se remémore ses rêves d’adolescent, son idée de devenir médecin de campagne, ses étés en Angleterre. Il évoque le parcours de cet aïeul hongrois émigré à Venise, son père représentant de commerce, pilote d’hydravion bombardier pendant la Première Guerre mondiale, resté une énigme pour lui. Il s’interroge sur notre rapport aux livres, compare la bibliothèque remplie d’éditions reliées de son père qu’il n’a jamais vu lire à celle de sa fille Charlotte dont « chaque livre marque sa présence, parce qu’il a été là à un moment où il a signifié quelque chose pour elle. Ses livres étaient là pour le temps présent, tous ensemble : ils lui ressemblent. » Arrigo Lessana s’est juré de ne pas donner de conseils à Angelo, il veut simplement être là pour lui, l’entourer de sa tendresse et lui souffler un peu de l’esprit et de la présence de sa mère défunte. Éd. Christian Bourgois, 96 p., 12 €. Élisabeth Miso
Gabrielle Lazure, Maman...Cet océan entre nous. « C’est le début d’une sensation (...) celle de vivre avec une femme qui appartient à un autre monde, d’avoir une mère originale, marginale, différente des autres mamans. (...) Je n’ai jamais ressenti de ta part un amour absolu. Les termes affectueux que tu emploies à mon égard sonnent faux. Pourtant, je t’aime comme chaque enfant aime sa maman. » C’est un récit autobiographique en forme de lettre d’amour et de pardon à une mère indifférente et fantasque, psychologue new-age. C’est une écriture qui se livre sans filet, raconte les premières années au Québec, les parents séparés, l’installation à Paris, et puis, les années de mannequinat pour vivre, le cinéma comme actrice, le besoin profond de reconnaissance maternelle, la consommation de drogue, beaucoup de drogues, le premier amour, le besoin d’amour, les rencontres, une époque... Le récit commence au moment où la mère malade d’un cancer, en train de mourir, demande à sa fille de lui pardonner, de lui raconter ce qu’elle n’a pas su voir. Elle lui écrit cette lettre, remonte le fil, mère à son tour elle a une fille, Emma qui grandit, différemment. Elle se souvient de sa propre naissance, de l’origine de son prénom, de ses années de travail à l’hôpital comme aide-soignante, de ses expériences bonnes, mauvaises, sa mère, distante fréquente un ashram. Elle éprouve la difficulté d’être élevée sans interdits. Actrice, elle décroche des rôles pour le cinéma, la télévision, tout en multipliant les contrats pour des marques de produits de beauté. Elle a des amants. Ils vont, ils viennent, il arrive que le téléphone ne sonne plus, que les contrats se fassent rares... Son père est mort, sa mère meurt, elle est, dit-elle une rescapée du non-amour. Pourtant c’est écrit tel un hymne à l’amour, empli de ce que sa mère à son insu lui a appris : transformer l’ombre en lumière. C’est abrupt et c’est émouvant, intelligent de clarté, de lucidité. Éd. l’Archipel, 20 p., 18 €. Corinne Amar
Marc Dugain, Intérieur jour. Il y a la petite histoire et il y a la grande – celle qui fascine l’auteur, romancier, essayiste, scénariste, cinéaste – il y a le roman et il y a le film, il y a l’écriture et il y a le cinéma. Et puis, il y a cette installation dans l’imaginaire, grandement développé dans la tête d’un enfant dont le grand-père est revenu atrocement défiguré de la Grande guerre, dont le père, lui-même, à la fin des années quarante, avait contracté la polio, foudroyé par la maladie, longuement immobilisé, meurtri, qui, longeait péniblement les trottoirs, deux béquilles sous les aisselles, dans une période déjà foudroyée par les circonstances ; il y a un enfant devenu adulte qui n’aura de cesse de fouiller le souvenir, le traumatisme personnel, les obsessions, et le ressort de la création, pour pouvoir sortir de ces obsessions. Dans Intérieur jour, l’auteur fait le récit d’une expérience cinématographique, fabuleuse, « intimement collective et terriblement éphémère », celle d’avoir adapté le roman historique de Chantal Thomas L’Échange des princesses, sur l’avènement et le mariage d’un roi : Louis XV, enfant, et rendu orphelin à cause d’une épidémie de variole – sans grands-parents, sans père sans mère, sans frère sans sœur, morts tous – voué à la dépression et appelé à régner, avant même d’avoir épuisé son enfance. À cet enfant roi, son désarroi, son impuissance vient se substituer la propre enfance de l’auteur, enfant à Dakar – il a trois ans sur la photo, assis par terre en face de son grand-père défiguré par l’obus dont il ne reste du visage que les yeux, et la lumière vivante dans les yeux... C’est un récit émouvant, éblouissant, qui mêle les précisions historiques d’une époque, sa fragilité, sa précarité, ses maladies, ses morts, ses jeunes princesses que l’on élevait « comme de la viande à marier pour perpétuer les dynasties iniques » et les préoccupations intimes, les souvenirs profonds, les romans précédents, l’histoire éternelle de l’enfance à réparer. Éd. Robert Laffont, 170 p., 18 €. Corinne Amar
ESSAIS
Traduction de l’anglais (États-Unis) Pauline Soulat. Publié en 1976 aux États-Unis et inédit en France, Le diable trouve à faire démonte le regard que porte Hollywood sur la société nord-américaine, révélant les préjugés et les fantasmes d’une Amérique qui fuit son histoire. Depuis ses premiers souvenirs de cinéma dans les années 1930 à Harlem, James Baldwin se penche ainsi sur son apprentissage de l’existence, sa compréhension des injustices de son pays et sur les origines de son combat contre les attaques raciales et homophobes. Critique cinématographique au vitriol, le texte rédigé à Saint-Paul de Vence à la fin de sa vie se lit comme des Mémoires. Enfant, l’écrivain se plonge de façon obsessionnelle dans la lecture de La Case de l’Oncle Tom de Harriet Beecher Stowe et du Conte de deux cités de Dickens : « (...) ils avaient quelque chose à me dire. J’avais cette façon enfantine de tourner autour de la question de l’être nègre. » Bill Miller, une enseignante blanche le prend sous son aile, lui prête des livres, l’emmène au théâtre et au cinéma. « C’est sans doute en partie grâce à elle, apparue si tôt dans ma vie terrifiante, que je n’ai jamais pu détester les Blancs (...) » Il est troublé par l’image du monde et des humains que lui renvoie l’écran et qui ne colle pas à sa réalité, à son expérience du racisme. Naissance d’une nation (1915), L’amour n’est pas un jeu (1942), La Chaîne (1958), Dans la chaleur de la nuit (1967), Devine qui vient dîner (1967), Lawrence d‘Arabie (1962), au fil des films qui ont imprimé sa rétine, James Baldwin décortique les stéréotypes du pouvoir politique et sexuel des Blancs véhiculés par l’industrie cinématographique, pointe les incohérences, l’approche caricaturale de la figure de l’homme noir dans les intrigues, le gouffre persistant entre Blancs et Noirs. « La racine de la haine des Blancs, c’est la terreur, une terreur sans fond et sans nom, qui se focalise sur les Noirs, émerge et se concentre sur cette figure effroyable, cette entité qui ne vit que dans leur tête. Mais la racine de la haine des Blancs, c’est la rage. L’homme noir ne déteste pas tant le Blanc, qu’il ne souhaite le voir s’écarter de son chemin et, plus encore, de celui de ses enfants. » En 1968, engagé par la Fox pour écrire un scénario à partir de l’autobiographie de Malcolm X, il s’introduit au cœur de la machinerie. Mais il renonce rapidement, toutes ses propositions de scènes étant systématiquement dénaturées par un autre scénariste, la question raciale rendue par là plus conforme à la vision des studios. Éd. Capricci, 144 p., 17 €. Élisabeth Miso
Judith Schlanger, Fuyant Poursuivant. Le livre s’ouvre sur l’image floue d’un bateau aperçu dans le brouillard. Nous allons nous en approcher, grâce à Judith Schlanger. À l’instar du capitaine Delano, qui supposant ce bateau en détresse, le rejoint aussitôt en barque, l’auteure aborde l’œuvre sans préambule. D’entrée de jeu, sa réflexion qui nous guide. Le remarquable esprit d’analyse de Judith Schlanger se double ici d’un art de la description dont les outils diffèrent d’un essai à l’autre. L’ouvrage réunit quatre essais probablement écrits à des années d’intervalles mais ils témoignent de la persévérance de la philosophe. Ses livres, quelque soit leur volume, sont toujours extrêmement fouillés, concentrés. Ils exposent avec calme et méticulosité une question qui vibre de bout en bout, à tel point qu’elle outrepasse les limites du texte ; c’est bien ce qui rend l’œuvre de Judith Schlanger si vaste, si exaltante. Elle nous donne à penser. C’est-à-dire que sa propre pensée, par sa teneur et sa forme, renouvelle celle de ses lecteurs. Ici, le choix des textes qu’elle étudie se porte sur des œuvres peu connues du public ou bien, s’agissant de Frankenstein de Mary Shelley, elle les aborde avec rareté. Ce qu’elle explore ici ce sont quatre histoires de poursuite et de persécution. Benito Cereno de Melville, Things as They Are or The Adventures of Caleb Williams de Godwin, Frankenstein de Mary Shelley et Roxana The Fortunate Mistress de Defoe sont relus sous un certain angle, celui de la chasse. Il s’agit donc de traque et de fuite. Le lien pervers qui unit l’oppresseur et sa victime est examiné par Judith Schlanger au fil du récit qu’elle relate avec autant de précision que de sobriété. Ce qu’elle analyse, à travers ces quatre œuvres, c’est d’une part le rapport intime des individus qui se traquent et d’autre part la réversibilité de l’oppression et de l’opprimé. Entre Godwin et Mary Shelley la filiation naturelle se voit transférée du récit du père au roman de sa fille. Godwin est le père de Mary Shelley. Dans Frankenstein, elle reprend le même fond d’angoisse que celui de Caleb Williams mais aussi la peinture de l’excès. Dans les deux ouvrages, il est question d’une poursuite obsessive. Judith Schlanger en saisit les mouvements, analyse les situations et en auscultent les débordements. Dans tous les cas étudiés ici on verra le couple « chasseur-chassé » se lier éternellement. Leurs rôles s’inversent à telle ou telle étape des quatre histoires féroces retracées dans le livre. Il en résulte une indestructible union, tissée de haine. Éd. Circé, 95 p., 13,50 €. Gaëlle Obiégly