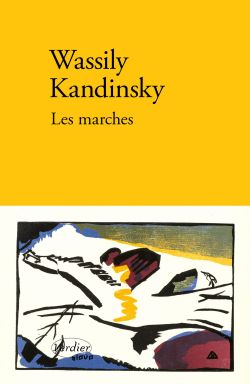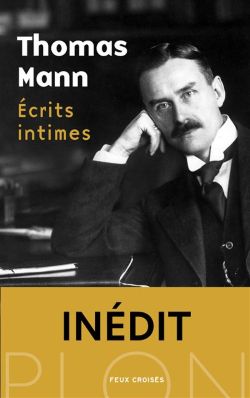Récits
Marianne Brooker, Intervalles. Traduction de l’anglais (Royaume-Uni) de Sabine Huynh. « Ma maman m’a certainement appris qu’un autre monde était possible et que notre imagination ne devait pas se limiter aux bornes que l’on nous a appris à respecter. Pour bien vivre et bien mourir, nous avons besoin de moyens. Nous ne pouvons nous contenter de rien de moins. » La mère de Marianne Brooker, une femme célibataire de la classe ouvrière, n’a eu de cesse d’enchanter l’existence de sa fille malgré les difficultés financières. Elle était de ces astres qui illuminent tout autour d’eux. À trente-neuf ans, le diagnostic est tombé : sclérose en plaques primaire progressive. Dans ce récit bouleversant, sa fille raconte avec quelle inventivité, quel courage et quelle détermination, elle a affronté la décennie terrible qui allait suivre. Au fil des années, elle a vu sa souffrance et sa précarité s’aggraver, l’aide sociale s’amenuiser sous l’effet de la politique d’austérité menée au Royaume-Uni. L’écrivaine a admiré la pugnacité avec laquelle sa mère a défendu les droits des personnes malades et handicapées, son engagement en faveur de l’aide à mourir. Un jour d’automne 2019, « privée d’une vie supportable et du droit légal de mourir », craignant de perdre son autonomie et sa liberté de choix, elle a décidé de ne plus s’alimenter ni de boire. Jusqu’au bout elles ont chéri leur lien unique, savouré ces moments harmonieux à lire, à écouter de la musique, à faire des collages et à imaginer le monde autrement comme « un enjeu, un pouvoir de transformation ». Marianne Brooker a pu canaliser ses peurs d’aidante grâce aux mots de Maggie Nelson, de Judith Butler, de Donald Winnicott et de bien d’autres encore qui se sont interrogés sur le bien vivre et le bien mourir. Elle dresse un constat lucide sur le sort réservé aux êtres les plus vulnérables et nous invite à repenser notre rapport à la mort, à notre interdépendance, à notre responsabilité collective. « Nous devons trouver de nouvelles façons de nous soutenir les uns les autres dans les moments les plus durs, les plus angoissants et les plus dangereux (…) » afin que des besoins aussi essentiels qu’un logement décent, se nourrir, des soins de santé ou palliatifs soient accessibles à tous. Éd. Globe, 256 p., 22 €. Élisabeth Miso
Biographies
Christophe Leclerc, Lee Marvin - Personne ne connaît mon nom. Christophe Leclerc, historien du cinéma, se penche sur le parcours mouvementé de Lee Marvin (1924-1987), cette figure marquante du cinéma américain, aussi explosive dans la vie que sur grand écran. À dix-huit ans, en 1942, Lee Marvin s’enrôle dans l’armée et rejoint le Corps des Marines dans le Pacifique Sud. L’enfer de la guerre ne cessera plus de le hanter. « Une fois qu’il est devenu acteur, Lee a porté son vécu à l’écran à la première occasion. Comme si c’était vital ou expiatoire, il a balancé à la figure des spectateurs son trauma et ses névroses durant quatre décennies. » Grâce à l’aide financière accordée aux soldats démobilisés, il se forme au théâtre à New York puis décide de tenter sa chance à Hollywood. Il se fait remarquer dans Règlement de comptes (1953) et dans L’Équipée sauvage (1953) aux côtés de Marlon Brando, mais désespère de percer en tant qu’acteur de premier plan. « Tout le monde connaît ma gueule, mais personne ne connaît mon nom. » Avec son physique, on ne lui confie que des rôles de second couteau, des personnages violents sans états d’âme. Il se voit décerner l’Oscar du meilleur acteur en 1966 pour sa prestation dans le western burlesque Cat Ballou. Mais ce sont des films comme Les Professionnels (1966) et Les Douze Salopards (1967) qui le hissent au rang de star internationale. Tourner avec lui ou partager son intimité n’est pas de tout repos, c’est un homme généreux, mais imprévisible, « inflammable », qui anesthésie ses tourments dans l’alcool. Les réalisateurs les plus talentueux comme Don Siegel, Robert Aldrich, Richard Brooks, Samuel Fuller ou John Boorman ont su capturer la profondeur de ce dur à cuire et révéler l’efficacité de son jeu sans artifices, basé sur la spontanéité et l’instinct. Son ami John Boorman, qui le dirigea notamment dans Le Point de non-retour (1967), racontera le combat qui attendait un réalisateur face à un acteur de cette trempe, qui n’hésitait pas à vous dire vos quatre vérités « s’il détectait quelque chose de faux ou de superficiel dans votre travail. Ce qui l’intéressait, c’était les limites affectives comme physiques. Il s’agissait de les exploiter, de les dépasser. » Éd. Capricci, 120 p., 11,50 €. Élisabeth Miso
Essais autobiographiques
Wassily Kandinsky, Les marches. Traduction du russe, notes et postface de Catherine Perrel. Dès son plus jeune âge, Wassily Kandinsky (1866-1944) s’est montré particulièrement sensible aux couleurs et aux sons, plus qu’aux objets eux-mêmes. Ce texte autobiographique publié d’abord en allemand en 1913, puis en russe en 1918, sonde sa vocation d’artiste à travers sa relation aux couleurs, des souvenirs intimes et des visions qui se sont imprimées en lui. Cette nouvelle traduction laisse éclater la puissance d’évocation du peintre, la fulgurance de sa pensée, la poésie de sa langue. Il a grandi à Moscou puis à Odessa, dans une famille cultivée qui a toujours encouragé sa fibre artistique. Bien que passionné par le droit, l’économie politique ou l’ethnographie, rien ne pouvait égaler à ses yeux « l’art qui seul parvint à (l)’emmener hors des limites du temps et de l’espace. » Mais il a douté de ses propres aptitudes à donner forme lui aussi, à des émotions aussi fortes que celles ressenties face aux toiles de Rembrandt à l’Ermitage ou des impressionnistes français exposés à Moscou en 1896. À trente ans, il renonce à enseigner le droit pour partir étudier la peinture à Munich. Pour Kandinsky, l’art n’a de sens que s’il naît d’une nécessité intérieure capable « de mettre à bas en un instant toutes les lois théoriques connues et toutes les limites. » Sa palette de couleurs mentale conserve à tout jamais l’image envoûtante de Moscou au soleil couchant et l’émerveillement provoqué par les costumes et le sens de l’ornement intérieur des Zyrianes dans la province de Vologda. De souvenirs en considérations théoriques, Kandinsky explore la mystérieuse alchimie des résonances visuelles et musicales qui ont irrigué sa quête créatrice et guidé son pinceau vers l’abstraction. « C’est sans doute grâce à ces impressions que prirent corps en moi mes désirs ultérieurs, les buts que j’allais poursuivre dans l’art. Pendant des années je cherchai les moyens de faire entrer le spectateur dans le tableau afin qu’il puisse s’y mouvoir, s’y dissoudre en s’oubliant. » Éd. Verdier, 96 p., 18 €. L’exposition Kandinsky, la musique des couleurs, coorganisée avec le Centre Pompidou, se tient jusqu’au 1er février 2026 à la Philharmonie de Paris. Élisabeth Miso
Thomas Mann, Écrits intimes. Traduit de l’allemand par Guillaume Ollendorff, édité et présenté par Bertrand Dermoncourt. C’est un recueil de fragments de journaux, essais, discours, lettres, qui révèlent la dimension la plus intime d’un écrivain trop souvent perçu comme l’incarnation de la rigueur allemande et du roman bourgeois. Écrits sur plusieurs décennies, ces textes tracent l’autoportrait d’un écrivain déchiré entre le devoir et ses propres tourments. « Quand je m’interroge sur l’origine héréditaire de mes prédispositions, je me remémore ces vers célèbres de Goethe et en conclus que moi aussi je tiens de mon père le « besoin de conduire ma vie scrupuleusement », mais de ma mère « la nature joyeuse », c’est-à-dire son orientation sensuelle et artistique ». Présentés dans un ordre chronologique, ils nous donnent à voir un visage de l’auteur que l’on connaît moins, celui d’un homme pris à la fois par le temps de sa vie personnelle et par les grandes questions de son époque. L’écrivain interroge sa propre homosexualité, son rapport à la respectabilité et au désir, mais aussi la responsabilité morale de l’écrivain. Nous avons d’abord un Thomas Mann jeune, héritier d’un XIXe siècle encore confiant dans la culture et la raison : une enfance à Lübeck, l’univers familial, la rigueur protestante, mais aussi les rêves et les failles d’un enfant déjà sensible à la beauté et à la mélancolie. Au fil des années, l’écrivain se découvre et s’analyse, médite sur la création, la discipline qu’elle exige, sur la tentation du désordre qui l’accompagne. L’art devient pour lui à la fois refuge et épreuve morale. On découvre un Thomas Mann plus ambigu que celui qu’on croit connaître. Il évoque sans détour son attirance pour les jeunes hommes, l’ambivalence de ses désirs. On est frappé par la lucidité avec laquelle il se regarde : ni complaisant ni rassuré. Et quand la barbarie s’étend, il écrit aussi sur la responsabilité de l’intellectuel face à la montée du nazisme, sur l’exil, sur la dignité de la culture menacée. Édition Plon, 240 p., 21 €. Corinne Amar
Sarah Kofman, Paroles suffoquées suivi de Comment s’en sortir ? Édition établie et annotée par Isabelle Ullern. « S’il n’y a plus de récit possible après Auschwitz, s’impose pourtant de parler, parler sans fin pour ceux qui n’ont pu parler parce qu’ils ont voulu jusqu’au bout sauvegarder sans la trahir la vraie parole. » La philosophe tente d’écrire là où les mots manquent, là où toute parole devient impossible. Deux essais exposent ses réflexions sur les limites de la parole, mais aussi sur la nécessité du témoignage après la Shoah. Elle s’avance, consciente que le langage ne peut pas dire l’horreur de la Shoah sans la trahir. Son écriture cherche à respirer au milieu de cette suffocation. Elle évoque, par fragments, la disparition de son père, rabbin, déporté à Auschwitz, la perte, le trou dans la mémoire et la douleur d’une parole empêchée. Parler devient presque une faute, mais se taire serait une autre forme de mort. C’est entre ces deux impossibilités qu’elle écrit. Dans Paroles suffoquées, dédié à son père, elle s’appuie sur L’Espèce humaine de Robert Antelme pour interroger la possibilité de témoigner de la Shoah. Dans Comment s’en sortir ?, elle se réfère au de Platon et montre comment la philosophie peut offrir des ressources pour sortir des impasses auxquelles tout individu est confronté au cours de son existence. Ses textes, composés de phrases brisées, de pensées interrompues, comme suspendues voire en apnée, font sentir la fragilité du témoignage. À travers les figures de Primo Levi, Paul Celan, Freud, Nietzsche ou Blanchot, Kofman médite sur la parole du survivant, sur cette voix qui cherche à dire l’indicible, sachant qu’aucun mot ne pourra jamais suffire. Elle interroge la culpabilité du survivant, celui qui reste alors que d’autres ont disparu. S’en sortir, ce n’est pas guérir, ni oublier, mais habiter la blessure, apprendre à respirer à nouveau malgré elle. Éd. Verdier, coll. poche, 254 p., 13 €. Corinne Amar