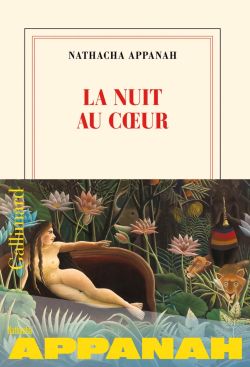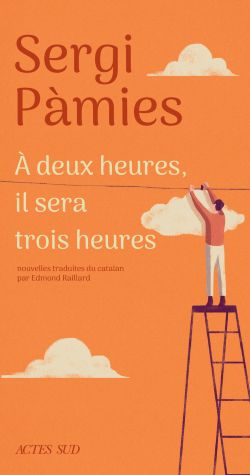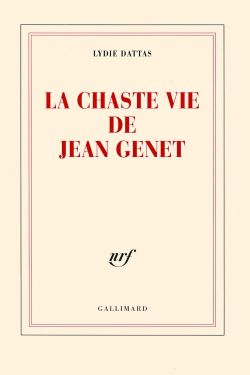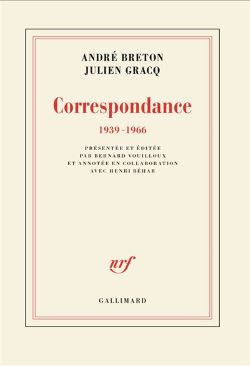Journaux
Al Alvarez, Nager sa vie. Journal d'un nageur. Traduction de l’anglais par Anatole Pons-Reumeaux. Dans son ultime ouvrage, Al Alvarez (1929-2019), poète, essayiste, critique littéraire et professeur d’université anglais, tient le journal, de 2002 à 2010, de précieux moments de nage dans les étangs d’Hampstead Heath, dans le nord-ouest de Londres. Pour l’écrivain septuagénaire qui n’a cessé de tester ses limites physiques (il a été un alpiniste chevronné), plonger dans les étangs, été comme hiver, est la meilleure manière de débuter une journée, d’apaiser son esprit et son corps décrépi et douloureux. L’eau froide lui procure sa dose d’adrénaline, maintient l’indispensable connexion entre monde des idées et monde physique. « Pour que mon imagination se mette en mouvement et que les mots prennent vie, j’ai besoin de me sentir vivant physiquement – c’est-à-dire que je dois sortir par gros temps et utiliser mon corps. C’est comme si je voyais mieux le monde et que je réfléchissais mieux en sortant l’explorer. » Depuis l’enfance, « la beauté et l’intimité de cet endroit sauvage au cœur de Londres » le captive. Sa langue poétique restitue la magie de ce qui l’entoure lorsqu’il nage : la grâce des oiseaux en vol ou sur l’eau, les arbres majestueux, le ciel changeant, les multiples odeurs végétales au fil des saisons. Il se délecte de ses conversations avec les maîtres-nageurs protecteurs et les autres habitués des lieux, tous d’anciens athlètes, qui tentent comme lui de s’adapter avec panache aux embarras du grand âge. La chronique de ces bains est aussi celle du temps qui passe, de son inexorable vieillissement. L’auteur aborde ainsi avec lucidité et humour les frustrations et les humiliations que génèrent un corps qui se dérobe, mais se concentre essentiellement sur tout ce qui rend la vie encore si désirable : l’amour de sa femme Anne, de ses enfants et de ses petits-enfants, l’amitié, la nage, le poker, la littérature. Comme l’écrit si finement Philippe Roth dans une lettre adressée à son cher Al Alvarez en avril 2013, ce livre est : « Une magnifique incantation à la vie dans ce qu’elle a de plus simple et de meilleur. Une litanie à la morsure vivifiante de l’eau froide, aux oiseaux sauvages et au ciel invariablement fascinant ». Éd. Métailié, 272 p., 21 €. Élisabeth Miso
Récits
Nathacha Appanah, La nuit au cœur. « J’avance sans bruit dans l’espoir d’un sens à ce récit triangulaire, j’écris dans le noir, à tâtons, essayant de retrouver des fils perdus, me heurtant au temps, au silence. » Dans La nuit au cœur, Nathacha Appanah entrelace trois histoires de femmes victimes de violences conjugales, trois versions glaçantes d’une même prédation masculine, du même dessein d’effacement. Il y a Chahinez Daoud brûlée vive en pleine rue par son mari, en mai 2021 à Mérignac. Emma, la cousine mauricienne de l’autrice, écrasée par son époux en décembre 2000. Et puis il y a cet « angle mort » dans sa trajectoire personnelle, que décortique Nathacha Appanah, ce trou sans fond dans lequel elle a lentement glissé à dix-sept ans, à l’Île Maurice, et dont elle n’a réussi à s’extirper qu’au bout de huit ans, devenue l’ombre d’elle-même. Depuis des années, depuis qu’elle sonde le destin tragique de ces deux femmes et son propre passé, elle se sait si étroitement liée à elles qu’elle a cherché à donner une forme à leur présence obsédante. Comme elles, elle a connu l’engrenage de l’emprise, la jalousie étouffante, l’asservissement. Elle a ressenti cette terreur morale et physique et a dû fuir pour échapper à la volonté destructrice de son compagnon, un journaliste et écrivain de trente ans son aîné. Elle est la seule à avoir survécu au cauchemar domestique, celle qui peut désormais par l’écriture interroger la barbarie, celle qui veut rendre à nouveau visible la luminosité de ces deux femmes réduites au silence, aux seuls contours de leur assassinat. Elle s’est longtemps documentée avant de se lancer dans cette enquête éprouvante. Elle a fait preuve d’une infinie délicatesse et sincérité pour gagner la confiance des proches de Chahinez et d’Emma, écartant toute inquiétude sur ses intentions littéraires. Nathacha Appanah a fendu l’épaisseur de sa nuit intime, pour en tirer, grâce au pouvoir des mots, un récit d’une force et d’une sororité saisissantes. « (…) écrire depuis le noir, écrire dans le noir et que ce geste rassemble tous ces morceaux éparpillés de ces deux femmes et de moi-même et que tout ça prenne la forme qui ressemble le plus à la chair humaine pour moi, un livre. » Éd. Gallimard, 228 p., 21 €.. Élisabeth Miso
Nouvelles
Sergi Pàmies, À deux heures il sera trois heures. Traduction du catalan par Edmond Raillard. Sergi Pàmies a tendance à penser que « n’importe quelle anecdote peut avoir un intérêt littéraire. » Le journaliste et écrivain catalan le prouve de façon virtuose, avec ce recueil de nouvelles, qui ont pour motif toutes sortes d’anecdotes savoureuses, en lien avec sa condition et son cheminement d’écrivain. À dix-huit ans, il écrivait des poèmes. Deux lettres, retrouvées dans un placard, le renvoient à la perte de sa virginité et à ses ambitions littéraires d’alors. L’auteur des missives, un célèbre poète, ami de ses parents (l’écrivaine Teresa Pàmies et l’homme politique Gregorio López Raimundo), avait lu quelques-uns de ses poèmes. Ses commentaires perspicaces l’ont « vacciné contre les virus de l’imposture les plus évidents. Alors que j’écrivais des vers narcissiques, j’ai commencé à adopter une démarche plus artisanale pour transformer en prose les turbulences qui les avaient inspirés. » Il est né à Paris en 1960 de parents réfugiés politiques espagnols qui ont décidé de retourner à Barcelone au début des années 1970. Il apprend le catalan à l’école, mais aussi par le biais des poèmes qu’il sélectionne dans la bibliothèque de ses parents, pour les chanter aux filles dont il veut s’attirer les faveurs en s’accompagnant à la guitare. Une invitation à Québec, pour un Salon du livre en 1991, le met en présence, lui écrivain débutant, de Manuel Vázquez Montalbán qu’il admire. Observer Montalbán réagir aux multiples sollicitations lui a révélé bien des aspects du métier d’écrivain. « L’entendre parler, c’était comme le lire : la maîtrise du discours, avec des substantifs et des verbes protéinés et des adjectifs et des adverbes de préférence amers. » Qu’il raconte une interview d’un auteur nobélisé qui vire au désastre pour raison de phobie des chats, une rencontre improbable avec un ange gardien proclamé, l’étude graphologique de sa signature par son ex-femme ou l’intimité un peu distante partagée avec ses enfants, Sergi Pàmies, avec l’humour et l’ironie affûtés qui le caractérisent, creuse cette idée que la fiction offre une dimension singulière à la réalité. Éd. Actes Sud, 128 p., 15 €. Élisabeth Miso
Biographies
Lydie Dattas, La chaste vie de Jean Genet. Petite légende dorée. « Il faut vraiment un poète pour entreprendre de réécrire sa vie, et le border une seconde fois dans son lit éternel : je devais le faire brièvement. » C’est à la fois une biographie, un hommage et une méditation littéraire sur l’existence de Jean Genet. Lydie Dattas, poétesse, entreprend de relire la trajectoire de Jean, né le 19 décembre 1910, à l’hôpital Tarnier de l’Assistance publique, dans le sixième arrondissement de Paris, de mère lingère et de père « beau parleur ». « Ce jour-là, il neigeait. » Elle redessine l’homme, l’ami, au regard de résonances secrètes : Jésus et les Malâmatî – ce mot tiré de l’arabe pour dire « celui qui cherche le blâme », du IXe siècle iranien et qui renvoie aux soufis et à leur doctrine : faire exprès de se comporter de manière presque contraire à ce qui se doit. L’auteure replace Genet loin de la figure sulfureuse qu’on lui prête, fait surgir sa richesse, les souffrances psychiques de l’adolescent privé d’amour et enfermé au bagne de Mettray, la poésie de la résistance intérieure, la beauté complexe de l’homme qu’elle a connu. L’amitié qu’elle partagea avec lui à partir de 1977, lorsque Genet s’installe dans l’immeuble « Bouglione », bien de la famille, à Pigalle, où elle vivait avec l’acrobate Alexandre Bouglione, lui permet un regard intime. Dans ce travail, Genet n’apparaît pas seulement comme l’écrivain des marges et de la transgression — prison, prostitution, homosexualité — mais comme un être traversé par une quête spirituelle ; un « innocent », l’homme de la pureté paradoxale. Le texte, dans sa brièveté, sa verve poétique, interroge plusieurs thèmes : la marginalité et la sainteté, la transgression et la grâce, la souffrance, la rébellion, sources de création et matrices poétiques. Comme si pour Genet, chaque journée de solitude, chaque heure de souffrance à Mettray, pinçant les cordes de ses nerfs, faisait croître son génie. La chasteté ou la grâce d’une pureté de neige. Éd Gallimard, 108 p., 12 €. Corinne Amar
Correspondances
André Breton, Julien Gracq, Correspondance (1939-1966). Édition établie par Bernard Vouilloux avec la collaboration d’Henri Béhar. André Breton à Julien Gracq : « Dimanche 13 mai 1939, Monsieur, J’ai lu d’un seul trait, sans pouvoir une seconde m’en détacher Au château d’Argol. J’ai passé la journée d’hier à vous relire et à échanger mes nouvelles impressions avec un ami, que vous avec conquis tout autant que moi. » André Breton (1896-1966) a 43 ans, Julien Gracq (1910-2007), 29 ans. Ce sont les lettres échangées entre le chef de file du surréalisme et l’auteur du Rivage des Syrtes, d’Un balcon en forêt, Autour des sept collines, sur près de trois décennies, de la veille de la guerre à la mort de Breton. Ces lettres, souvent espacées – parfois six mois, un an – tracent les lignes d’une amitié à distance, faite d’admiration réciproque, de pudeur et de liberté. Gracq écrit d’abord à Breton avec la foi d’un jeune écrivain qui envoie à son aîné son premier roman qu’il sait né dans le sillage du surréalisme, mais en même temps qu’il veut affranchir de toute école. Breton est très vite impressionné, attentif, il répond avec un mélange de rigueur et de bienveillance. À travers ces échanges, on découvre deux solitudes qui s’accordent. Breton voit en Gracq une continuité possible de l’esprit surréaliste, détaché de la doctrine ; Gracq, lui, reconnaît en Breton le dernier vrai poète de l’absolu. La guerre interrompt ce dialogue, et la reprise après la Libération de leurs échanges se fait sur un ton plus grave, où le silence prend autant de place que les mots. Gracq continue au fil des années à l’appeler Monsieur Breton et de son côté, lorsqu’il reçoit les épreuves corrigés d’un essai de Gracq, un 8 juin 1947, là encore, Breton fait part de son « transport ». Gracq fait apparaître Breton non pas seulement comme le meneur du groupe surréaliste, mais comme un écrivain à part entière, dont le surréalisme ne serait que l’expansion. Les dernières lettres de Breton témoignent de leur fraternité inaltérable Éditions Gallimard, 235 p., 21 €. Corinne Amar