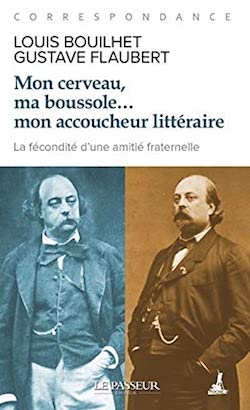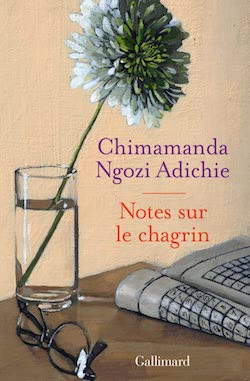CORRESPONDANCES
Françoise Sagan, Écris-moi vite et longuement. Lettres à Véronique Campion. Préface d’Olivia de Lamberterie. Françoise Sagan et Véronique Campion se rencontrent à seize ans, en 1951, dans une boîte à réviser le bac. Toutes deux affichent une grande liberté d’esprit et croquent la vie à pleines dents. Jusqu’au début des années soixante, Plick et Plock, comme elles se surnomment mutuellement, sont très liées. Elles partagent la même fantaisie, la même gaieté, le même tempérament rebelle, le même goût pour la vitesse et l’alcool. Les lettres que Françoise Sagan adresse à sa « Chère Verinoc », à sa « Chère enfant », à sa « Chère folasse » (celles de Véronique Campion n’ont pu être retrouvées), laissent filtrer sa tendresse et sa vivacité intellectuelle. La parution en 1954 de Bonjour tristesse la jette à dix-huit ans dans le tourbillon de la célébrité. En 1955, elle décrit son séjour excitant à New York où elle fait la promotion de son roman, les interviews rébarbatives le jour, les nuits folles à s’amuser. « Je mène une vie de chien savant, je savoure le succès avec force whiskies, mais la ville est drôlement belle. Tu verras ça, c’est fou. Je ne peux pas te dire si je suis heureuse ou pas, je n’ai pas le temps de le savoir. » « Le charmant petit monstre » publie avec succès, voyage, gagne de l’argent qu’il dépense sans compter, vit entouré d’amis, joue au casino, conduit des voitures à toute allure. En vacances à Cajarc, à Hossegor, aux Canaries, en reportage à Beyrouth ou en tournée littéraire aux États-Unis, où qu’elle se trouve, l’écrivaine pose sur les choses et les êtres son regard malicieux et aiguisé, ne se prend pas le moins du monde au sérieux, s’agace des questions indiscrètes des journalistes et fuit à toutes jambes la tiédeur et l’ennui. Véronique Campion est à bord de l’Aston Martin qui se fracasse le 13 avril 1957 près de Milly-la-Forêt. Grièvement blessée lors de l’accident, Françoise Sagan se voit prescrire du Palfium et doit ensuite entamer une cure de désintoxication. Épisode douloureux qui marque le début de sa dépendance aux médicaments, à l’alcool et aux drogues et qu’elle évoque avec pudeur. « Décidément, j’ai horreur des épreuves. Rien ne nous apprend moins, ne nous amuse moins, ne nous développe moins l’intelligence – et l’humour – que ce genre d’ennuis. » Éd. Stock, 128 p., 17 €. Élisabeth Miso
Gustave Flaubert, Louis Bouilhet, Mon cerveau, ma boussole… mon accoucheur littéraire. Ils sont nés la même année en 1821, même collège, mêmes classes à Rouen, depuis leurs treize ans ; amis avant que d’être pairs en littérature, d’une ressemblance physique incroyable – sur la couverture, leurs deux portraits, adultes, juxtaposés, tels des sosies – et tous deux, fils de médecins. Amitié indéfectible qui irriguera toute leur vie. Louis Bouilhet fera paraître, en 1851, Melaenis, un conte romain qu’il dédie à Gustave Flaubert, tandis que Madame Bovary, publié en 1856, sera dédié à Louis Bouilhet. Pour l’un comme pour l’autre, lorsqu’ils ne se retrouvent pas à Croisset, dans le cabinet de travail de Flaubert ou dans son domicile parisien, la correspondance est un mode d’échange et de confrontation intellectuelle indispensable, lieu par excellence du discours critique et théorique. Dans ce long dialogue esthétique, amical et littéraire entrepris entre 1846 et 1869 (année de la mort de Bouilhet, son alter ego, son ami, son frère), œuvre en cours, filles de passage, jeunes garçons (au Caire), sensations du moment, impatiences, allégresse, absolument tout y passe et se partage. En 1850, Flaubert est au Caire, Bouilhet, à Rouen, l’un et l’autre s’écrivent combien l’autre lui manque. « Le Caire, 15 janvier. (...) Le soir, quand tu es rentré, que les strophes ne vont pas, que tu penses à moi, et que tu t’ennuies, appuyé au bout du coude sur ta table, prends un morceau de papier et envoie-moi tout, tout. J’ai mangé ta lettre et l’ai relue plus d’une fois. En ce moment, j’ai l’aperception de toi en chemise auprès de ton feu, ayant trop chaud, et contemplant ton vit. À propos, écris donc cul avec un L et non cu. Ça m’a choqué (...). » Il appelle Bouilhet mon Solide, et signe Ton vieux. Louis Bouilhet est déjà célèbre et reconnu par ses pairs, Flaubert en est encore à ses débuts, et le rôle que jouera le premier dans la composition des romans du second est fondamental… Le Passeur éd. 472 p., 9,50 €. Corinne Amar
RÉCITS (AUTOBIOGRAPHIQUES)
Chimamanda Ngozi Adichie, Notes sur le chagrin. Traduction de l’anglais (Nigeria) Mona de Pracontal. « J’écris sur mon père au passé et je n’arrive pas à croire que j’écris sur mon père au passé. » Le 10 juin 2020, Chimamanda Ngozi Adichie a perdu son père, James Nwoye Adichie professeur émérite de statistiques, professeur honoraire de l’université du Nigeria. Sa mort a été un véritable séisme, une expérience insoupçonnée de la souffrance, tant sur le plan psychique que physique, qui l’a totalement déstabilisée. « J’ai eu des deuils par le passé, mais c’est maintenant seulement que je touche au cœur du chagrin. Maintenant seulement que j’apprends, en cherchant à tâtons ses bords poreux, qu’il ne se traverse pas. » Quelques jours auparavant, les parents domiciliés à Aba, la ville ancestrale de la famille dans le sud-est du Nigeria, conversaient encore par Zoom (pandémie de Covid-19 oblige) avec leurs six enfants éparpillés entre le Nigeria, l’Angleterre et les États-Unis. Il y a eu le choc de l’annonce de sa mort et l’intolérable impossibilité pour raison de confinement de se rendre sur place. En de courts chapitres, l’autrice d’Americanah, ausculte les bouleversements que provoque ce deuil en elle, tous les sentiments qui l’assaillent alors : la surprise, le déni, la colère, l’angoisse, l’effondrement, l’impuissance, le profond désarroi de vivre cela à distance, d’être séparée de ses proches. Elle ne peut supporter la banalité des messages de condoléances, même si les personnes font preuve d’empathie, leurs paroles l’agressent littéralement, incapables de traduire l’indicible, de coller à la réalité de ce qu’elle ressent. « On apprend combien les condoléances peuvent paraître creuses. On apprend combien le chagrin est question de langue, l’échec de la langue et la tentative de s’y raccrocher. » Elle se réfugie donc dans l’écriture, à la recherche d’un sens à donner à cette « déroute permanente ». Elle relit les lettres que son père lui écrivait quand elle est partie étudier aux États-Unis, regarde les vidéos qu’elle a réalisées de lui, se souvient de scènes de son enfance, de gestes tendres. Elle prenait un plaisir infini à être auprès de lui, à l’écouter parler de ses ancêtres. Elle aimait tout ce qui transpirait de sa personne, son intégrité, l’extrême attention qu’il portait aux autres, la confiance qu’il a donnée à ses enfants, son attachement à l’identité et à la culture igbos, son humour pince-sans-rire. À ce père adoré, Chimamanda Ngozi Adichie clame son amour éternel. Éd. Gallimard, 108 p., 9,90 €. Élisabeth Miso
Betty Milan, Pourquoi Lacan. Elle fait son analyse avec Lacan dans les années 1970 : la première phrase du livre nous l’annonce d’emblée. Quarante ans plus tard, elle revient sur cet épisode déterminant de sa vie, qui lui a fait quitter son pays, l’homme qu’elle allait épouser, pour entreprendre son analyse avec celui qui régnait à cette époque sur le milieu intellectuel parisien et tenait son séminaire dans le grand amphithéâtre de la Faculté de droit, place du Panthéon, à Paris : Jacques Lacan. Saisir le moment opportun : voilà ce qu’elle comprend la première fois, de son bref entretien avec Lacan à la porte de son Cabinet. Elle est brésilienne et vit à Sao Paulo, ne maîtrise pas le français, est psychanalyste dans son pays, diplômée en médecine, et faisant partie de la Société brésilienne de psychanalyse (SBP). Elle veut faire connaitre Lacan dans son pays et s’en ouvre au maître – jusqu’au moment où elle comprend qu’une chose s’impose telle une évidence : faire une analyse avec lui. Elle veut se départir de ses angoisses, elle veut surtout comprendre, se comprendre, s’accepter elle, descendante d’immigrants libanais, victime de la xénophobie des autres et de la sienne propre. Elle s’installe à Paris, suit le séminaire de Lacan, décrit cette effervescence de la salle immense avant qu’il n’arrive, sa venue alors que la salle est évidemment comble, et tout à coup, redevenue silencieuse ; elle évoque le discours du maître. « Lacan se préoccupait peu d’être immédiatement intelligible. Il mettait l’accent sur le Nachträglich, ce concept freudien traduit en français par « après coup » – signifiant que certains faits ne peuvent être compris qu’après qu’ils se sont produits – et la pratique de Lacan reposait sur cette notion, dans son séminaire comme dans sa clinique. » Elle revient sur l’importance de la langue et ce long travail opéré afin d’accepter ses origines, son identité, celle qu’elle est. Éd. Érès, traduit du brésilien par Danielle Birck, 156 p., 12 €. Corinne Amar
ROMANS (AUTOBIOGRAPHIQUES)
Claudia Durastanti, L’Étrangère. Traduction de l’italien Lise Chapuis. Claudia Durastanti, née en 1984, a grandi entre New York et la Basilicate. Jusqu’à ses six ans, elle a vécu à Brooklyn dans une famille d’immigrés italiens à l’anglais approximatif. Ses deux parents étaient sourds et refusaient d’apprendre la langue des signes, s’obstinant à lire sur les lèvres et à adopter toute une stratégie de dissimulation de leur handicap. Communiquer avec eux était éreintant, exigeait beaucoup d’attention, d’invention et d’abolir toute référence à la fiction. Ils considéraient « que les mots ne signifient rien si ce n’est quand ils sont à prendre littéralement, et que tout autre résidu est une grande perte de temps et de sens : la vie se séduit en silence, s’hypnotise, et tout le reste est un échec. » Pour une écrivaine qui manie le langage figuratif, chaque conversation avec eux est toujours une lutte. Le langage a donc été d’emblée une question centrale, un univers étrange, un espace de questionnement et d’exploration infini. En 1990, après son divorce, sa mère s’est installée avec ses deux enfants dans un village de la Basilicate. Elle était marginale, ne travaillait pas vraiment, se rêvait artiste peintre. Elle entraînait souvent sa fille dans des marches interminables au hasard des villages du val d’Agri, lui faisant souvent manquer l’école. La romancière se souvient de leur pauvreté, du sentiment désagréable d’être perçue par les autres enfants comme une étrangère, des journées entières à lire cachée dans le grenier. Chaque été elle retournait à Brooklyn chez ses grands-parents maternels. « Ma mère me manquait quand elle disparaissait, mais elle, c’était une nébuleuse, et mon père une galaxie très noire qui neutralisait toutes les théories de la physique : mon frère a été la première matière autour de laquelle je me suis condensée. » Son frère, de six ans son aîné, a été celui qui lui a fait comprendre que maîtriser la langue et s’éduquer, était le seul moyen de trouver sa place en ce monde. C’est en entrant à l’université qu’elle a pris conscience de sa classe sociale, qu’elle a été confrontée à la bourgeoisie. Longtemps elle a eu l’impression de ne pas avoir les bons codes, d’être une usurpatrice, de ne pas savoir comment se comporter. Dans ce très beau roman autobiographique Claudia Durastanti raconte comment elle s’est construite dans cette appartenance à différentes langues et à différents lieux. Comment elle est parvenue à trouver son propre mode d’expression et à envisager l’extranéité comme un vrai gage de liberté. « Nous vivons de textes narratifs qui nous sauvent, que nous soyons heureux ou que nous ne le soyons pas. » Éd. Buchet-Chastel, 288 p., 20 €. Élisabeth Miso